Les plantes vivaces à croissance décorative appartiennent à la famille des Lamiacées. Ordre des Lamiales (N. N. Tsvelev)
-Les représentants de cette famille sont facilement reconnaissables à la structure de la corolle des fleurs, qui possède un long tube et un pharynx à deux lèvres, rappelant la gueule béante d'un animal de conte de fées. Bien qu'une corolle d'aspect similaire soit présente dans plusieurs autres familles de plantes à fleurs (par exemple chez de nombreuses Norichacées), elle est particulièrement caractéristique des Lamiacées. Non moins unique est le fruit des Lamiaceae, constitué de 4 lobes à une seule graine en forme de noix ou rarement en forme de drupe, tandis que chez les Norichineaceae, dont la structure de la corolle est similaire, le fruit est généralement une capsule à plusieurs graines. Parmi les importants caractéristiques distinctives Les Lamiacées ont également des feuilles opposées (très rarement verticillées), généralement entières sans stipules et des tiges généralement tétraédriques. L'odeur aromatique caractéristique de la plupart des espèces de Lamiacées est très importante, elle est déterminée par la présence sur tout ou partie de la plante de glandes sécrétant huiles essentielles composition complexe (ils comprennent des alcools aromatiques, des phénols, des terpènes, des aldéhydes et d'autres composés organiques). C'est la présence de ces huiles qui est largement déterminée utilisation pratique Les Lamiacées comme plantes techniques, médicinales et aromatiques.
, 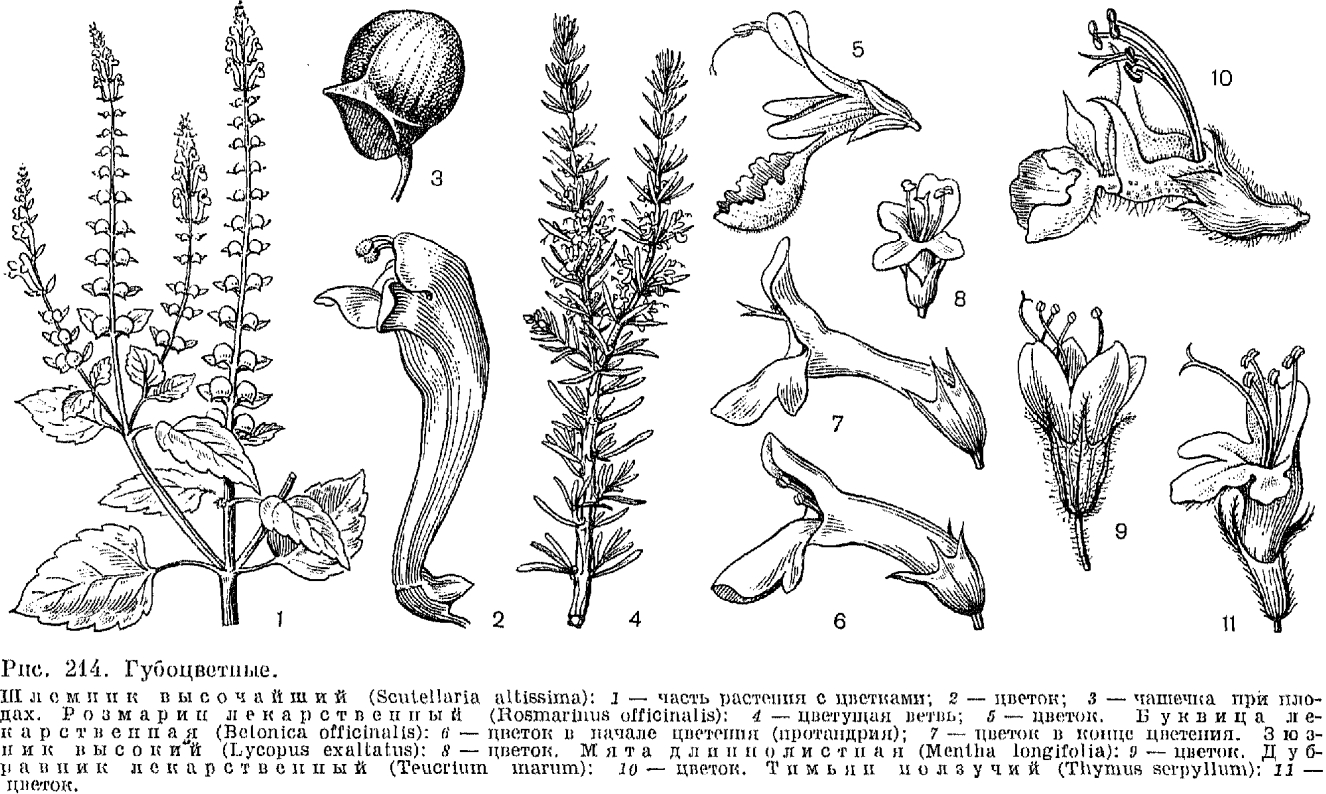
La plupart des Lamiacées sont des herbes et des arbustes. Cependant, parmi eux, notamment dans les régions tropicales et subtropicales, il existe de nombreux arbustes, dont un exemple est le romarin médicinal (Rosmarinus officinalis, tableau 55), répandu dans la région floristique méditerranéenne - arbuste à feuilles persistantes avec de petites feuilles linéaires et des fleurs bleu-violet (à presque blanches) (Fig. 214). Lamiacées - les arbres ne se trouvent que sous les tropiques, mais, contrairement à la famille étroitement apparentée des Verbenaceae, à prédominance ligneuse, ils ne constituent que quelques espèces de deux genres américains : Hyptis et Leucosceptrum. Parmi elles, la « championne » en hauteur est l'espèce brésilienne H. membranacea, qui atteint une hauteur de 12 à 15 m, tandis que d'autres Lamiacées ligneuses n'atteignent généralement pas une hauteur de 5 m. Sous les tropiques, il existe également quelques vignes auxquelles ils appartiennent uniquement au genre américain Salazaria, à certaines espèces de scutellaire (Scutellaria, tableau 55) et au genre hawaïen Stenogyne.
Les tiges des Lamiacées herbacées sont généralement dressées et ne nécessitent pas de support, bien qu'il existe des espèces dont les tiges rampent sur le sol et s'enracinent dans les nœuds (par exemple, bourgeon à feuilles de lierre - Glechoma hederacea). Chez le tenace rampant (Ajuga reptans), en plus des pousses reproductrices dressées, des rosettes arquées se forment à l'aisselle des feuilles, dirigées vers le sol et enracinées aux extrémités. pousses végétatives, semblable aux moustaches de fraise. Une rosette bien développée de feuilles basales, qui persiste pendant la floraison de la plante, se retrouve chez de nombreuses Lamiacées herbacées (par exemple, chez certaines sauges - Salvia).
racine principale persiste souvent tout au long de la vie de la plante, meurt moins souvent et est remplacée par des racines adventives s'étendant soit à partir de la base de la tige, soit par des racines rampantes s'étendant à partir de celle-ci pousses souterraines- des rhizomes caractéristiques de nombreuses espèces de Lamiacées. Assez rarement parmi les Lamiacées, on trouve des espèces à drageons, par exemple le tenace de Genève (Ajuga gennevensis, tableau 55). Chez de nombreuses espèces côtières qui vivent dans des habitats gorgés d’eau, des cavités aériennes ou des zones de tissus aériens se forment dans les rhizomes. Certaines Lamiacées ont des racines tubéreuses et épaissies, qui sont utilisées comme aliment dans les pays tropicaux.

Avec des feuilles opposées, les paires proches alternent transversalement les unes avec les autres. La conséquence en est la nature tétraédrique des tiges des Lamiacées, et les bords peuvent être plats, convexes ou concaves. Parmi les Lamiacées, il existe peu d’espèces à feuilles verticillées. Il s'agit notamment de l'arbuste australien original Westringia (Westringia) avec de petites feuilles entières disposées en verticilles de 3 à 6 (Fig. 215). Une disposition régulière des feuilles n'a été observée que dans les premières feuilles des semis des genres Phlomis et Betonica.
Les feuilles des Lamiaceae sont généralement entières et souvent entières, bien que l'on trouve également des feuilles pennées divisées (par exemple chez Salvia scabiosifolia). Connue comme espèce nue ou presque nue, par ex. sauge décorative brillant (S. splendens) et espèce densément couverte de poils. Parmi ces dernières, des espèces méditerranéennes telles que le mouron crétois (Stachys cretica) et l'ironweed de Crimée (Sideritis taurica) ne sont pas inférieures en beauté au célèbre edelweiss alpin. Parmi les poils, les plus courants sont les poils simples multicellulaires. Les poils capités, dont la tête fonctionne comme une glande produisant de l'huile essentielle, se trouvent chez de nombreuses Lamiacées.
En règle générale, les fleurs à cinq chaînons et, en règle générale, bisexuées des Lamiacées sont situées à l'aisselle des feuilles qui sont inchangées ou modifiées en bractées. Ce n'est que dans quelques cas (par exemple chez les espèces de scutellaire) qu'elles sont solitaires ; généralement les fleurs forment ce qu'on appelle de faux verticilles, composés de deux inflorescences opposées portant des bractées. Les axes de toutes les inflorescences primaires, souvent considérablement raccourcis, et leurs fleurs constitutives semblent être situées directement à l'aisselle des feuilles, formant des inflorescences en forme d'épi. Parfois, l'axe de l'inflorescence générale est considérablement raccourci et l'inflorescence entière devient capitée, par exemple chez Ziziphora capitala et dans le grand genre américain hiptis. Chez le bec-de-lièvre (Lagochilus), commun dans les régions montagneuses d'Asie centrale, les fleurs situées à la base des faux verticilles sont transformées en de puissantes épines qui protègent la plante de la consommation des herbivores. Chez certaines autres Lamiacées, des bractées ou feuilles supérieures, et parfois des dents de feuilles.
Le calice et la corolle des Lamiacées sont généralement formés de 5 folioles fusionnées avec leur partie principale en un tube. Seuls quelques genres, comme le genre Preslia de la Méditerranée occidentale, ont un périanthe à quatre chaînons. Le calice des Lamiaceae peut avoir une grande variété de formes : tubulaire, en forme de cloche, en forme d'entonnoir, sphérique, et dans le pharynx, il peut être soit à deux lèvres sans dents, soit à 5(4) dents avec des dents du de longueurs identiques ou différentes (dans ce dernier cas, le calice est également plus ou moins bilobé). Contrairement à la corolle, dont les modifications sont associées à l'adaptation à la pollinisation, les modifications du calice sont généralement associées à l'adaptation à la répartition des fruits. Souvent (par exemple, dans l'agripaume), les dents du calice ont l'apparence d'épines courbées sur le côté. Parfois, le calice entier ou ses dents grandissent considérablement, augmentant la dérive du calice à mesure que les graines sont dispersées par le vent, ou le calice devient de couleur vive, jouant un rôle en attirant les insectes ou les oiseaux pollinisateurs, par exemple le calice rouge vif de Salvia splendor . Le calice du grand genre (environ 300 espèces), presque cosmopolite, Scutellaria, est très original. Ici, il a deux lèvres avec des lèvres entières et, une fois le fruit mûr, il se brise en deux parties qui ressemblent à des valves : la partie inférieure restante et la partie supérieure tombant. La partie supérieure du calice de nombreuses espèces de ce genre porte également un pli transversal en forme d'écaille - le scutellum. Scutellaria présente un certain nombre d'autres caractéristiques qui distinguent ce genre des autres genres de Lamiaceae (y compris l'absence de glandes huileuses essentielles), et ce n'est pas un hasard si certains auteurs ont même proposé de le séparer en une famille spéciale des Scutellariaceae.
, 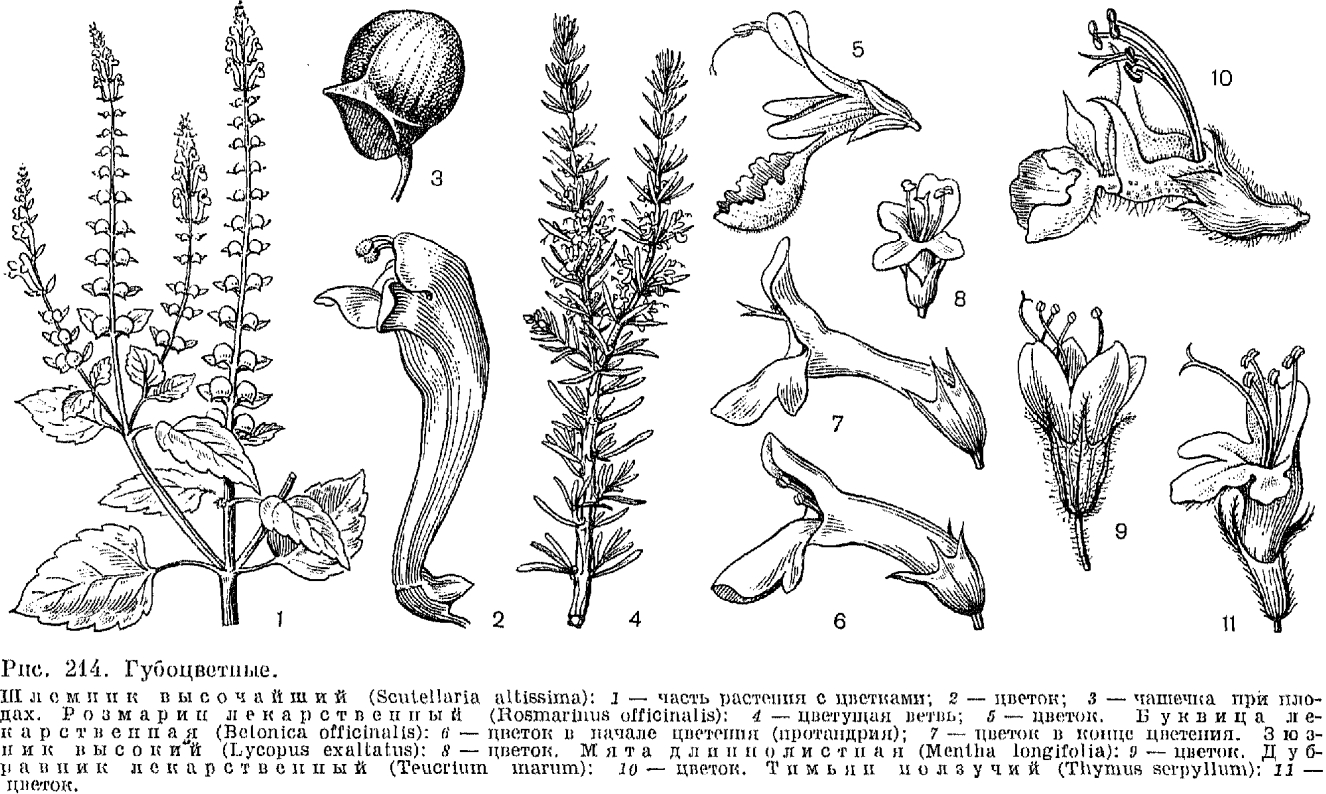
Comme mentionné ci-dessus, la corolle des Lamiacées est généralement divisée en deux lèvres, dont la supérieure est formée de 2 pétales et la inférieure de 3 pétales. La lèvre supérieure peut être plate ou convexe, parfois elle est entière, de sorte qu'aucune trace de la présence de 2 pétales n'est retrouvée. La lèvre inférieure est presque toujours plus grande (un site d'atterrissage pour les pollinisateurs), trilobée avec un lobe moyen plus grand et souvent à son tour bilobé. Parfois ses lobes latéraux présentent des appendices filiformes, comme ceux du lamium (Lamium). La structure des corolles des genres Teucrium et Ajuga (tableau 55) est assez originale. Le premier d'entre eux n'a aucune lèvre supérieure et les étamines, ainsi que le style, dépassent loin de la gorge de la corolle (Fig. 214). Cependant, les 2 lobes supérieurs, qui forment habituellement la lèvre supérieure, n'ont pas ici disparu, mais sont rattachés à la lèvre inférieure de la corolle, qui est composée non pas de 3, mais de 5 lobes. La lèvre supérieure tenace est très courte par rapport à la longue lèvre inférieure, et la corolle semble également être à une seule lèvre. Chez le basilic (Ocimum) et les genres apparentés, la lèvre supérieure de la corolle est formée non pas de 2, comme d'habitude, mais de 4 pétales. La lèvre inférieure est constituée d'un seul pétale plat ou concave. Pour la fleur d'éperon liée au basilic (Plectranthus) s'étendant vers le sud Extrême Orient, il est également caractéristique qu'il y ait un gonflement dans la partie inférieure du tube de la corolle, et chez certaines espèces ce gonflement se transforme en un véritable éperon. Certains genres de Lamiaceae, dont Lycopus, fig. 214, ont une corolle courte et presque actinomorphe à 4-5 lobes. La couleur des corolles des Lamiacées peut être rose, violette, lilas, bleue, jaune, blanche, souvent dans diverses combinaisons.
Il y a généralement 4 étamines dans les fleurs des Lamiacées, attachées au tube de la corolle. Dans le genre tropical Coleus (Coleus, tableau 55) et dans certains genres apparentés, les filaments des étamines poussent ensemble, formant un tube court. Il existe parfois un rudiment d'une cinquième étamine, qui a probablement disparu suite à la transformation de la corolle actinomorphe en corolle zygomorphe au cours de l'évolution des Lamiacées. La paire d'étamines postérieures est généralement plus courte que la paire antérieure, mais parfois, par exemple dans l'herbe à chat (Nepeta), la relation inverse se produit. La menthe (Mentha), avec son périanthe presque actinomorphe, possède les 4 étamines presque de la même longueur. La réduction des étamines au sein de la famille va encore plus loin - jusqu'à 2 étamines, et 2 étamines postérieures sont réduites, restant parfois sous forme de staminodes. Deux étamines sont caractéristiques, par exemple, du genre méditerranéen romarin, sauge et du genre nord-américain-mexicain Monarda. Sous le lieu de fixation des étamines se trouve souvent un anneau poilu - un dispositif de protection du nectar.
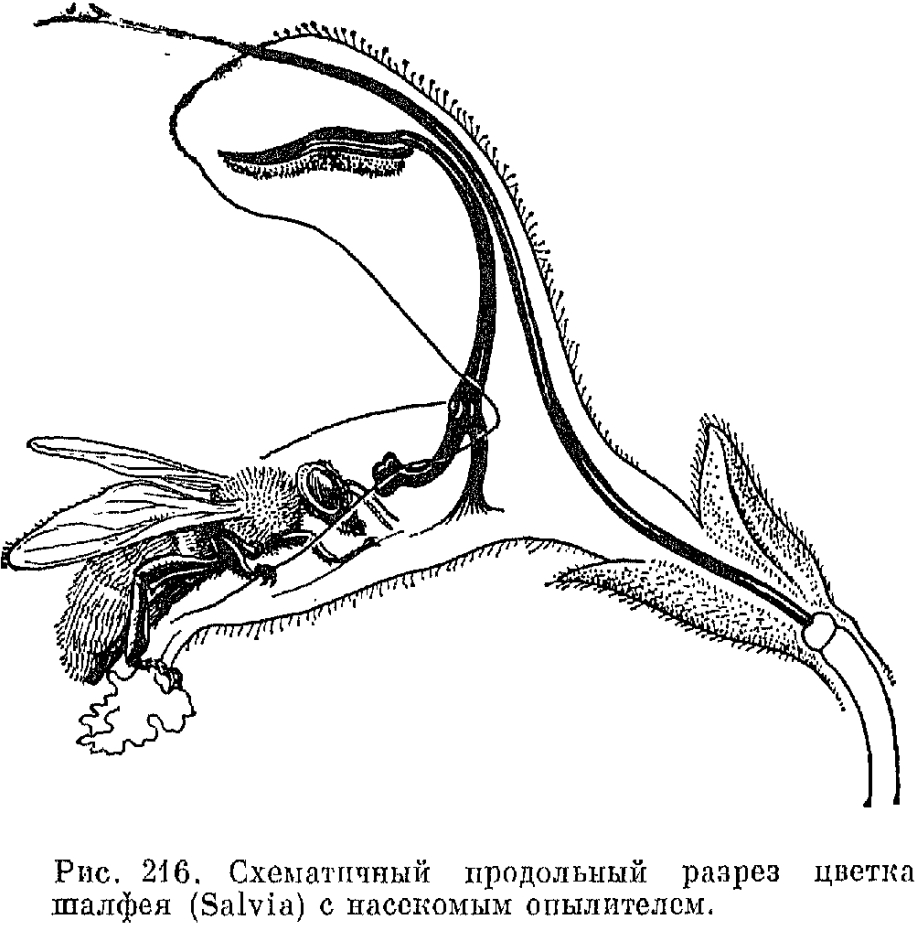
Les anthères des Lamiacées ont des formes différentes. Leurs nids sont généralement également développés, moins souvent l'un d'eux (généralement le devant) est moins développé que l'autre ou réduit. Chez de nombreuses espèces de sauge, la spécialisation des étamines est allée plus loin en raison de la très parfaite adaptation des fleurs à la pollinisation par certains insectes (fig. 216). Chacune des anthères des deux étamines présentes ici s'est transformée en une sorte de dispositif à levier, à une extrémité duquel se trouve un nid d'anthères supérieur entièrement développé, et à l'autre, un rudiment généralement en forme de cuillère du second (inférieur). nid d'anthère. Le filament, qui s'est développé en un long filament (une partie de l'étamine située entre les nids d'anthères), est attaché de manière mobile à un filament très court. La réduction complète de l'une des alvéoles d'anthère des deux étamines supérieures se produit également dans la calotte crânienne et l'anthère glandulaire, mais l'allongement du ligament ne se produit pas ici.
Les nectaires des Lamiacées proviennent de la base des carpelles. La plupart type régulier Le nectaire est un disque à 4 lobes ou dents. Chaque lobe peut sécréter du nectar, mais cette capacité dépend du degré de développement des lobes eux-mêmes et de leur système conducteur. Les insectes trouvent du nectar sous l'ovaire dans la partie inférieure de la corolle, mais lorsque le nectar est libéré en abondance, il remplit uniformément toute la partie inférieure du tube de la corolle et l'insecte n'a qu'à abaisser sa trompe dans le tube pour récolter beaucoup de nectar. . Dans la calotte, le disque solide nectarifère est généralement remplacé par un nectaire en forme de fer à cheval comportant 3 à 5 lobes inégaux.
La structure du gynécée de toutes les Lamiacées a beaucoup en commun. Il est toujours formé de deux carpelles avec un nombre de nids correspondant au nombre de carpelles. Cependant, chacun des nids est divisé en deux par une fausse cloison, ce qui fait que l'ovaire devient quadrilobé, avec un ovule dans chaque lobe. Le style de la plupart des Lamiacées s'étend à partir de la base des lobes de l'ovaire (gynobasique), mais dans les sous-familles Ajugoideae et Prostantheroideae, il n'est généralement pas complètement gynobasique ou s'étend même presque depuis le sommet de l'ovaire, comme dans la famille des verveines. Dans la calotte, l'ovaire n'est pas sessile, comme chez les autres Lamiacées, mais est situé sur une tige formée par la partie inférieure fortement rétrécie du gynécée.
Bien que les fleurs des Lamiacées soient généralement bisexuées, dans de nombreux genres (par exemple, menthe, thym - Thymus), il existe également fleurs femelles avec des étamines vestigiales, ayant généralement une corolle plus petite et de couleur pâle. Beaucoup moins courant fleurs mâles avec un gynécée rudimentaire (par exemple, chez certaines espèces d'herbe à chat). Des fleurs cléistogames avec une corolle qui ne dépasse pas du calice et ne tombe généralement pas peuvent être observées dans la mauvaise herbe annuelle Lamium amplexicaule, commune dans de nombreuses régions de l'URSS. Ces fleurs se forment généralement dans des conditions défavorables conditions climatiques: au début du printemps ou à la fin de l'automne.

Le fruit des Lamiacées est constitué de 4 lobes à une seule graine et pour la plupart en forme de noix, ayant des formes très différentes. Lors de la fructification, la corolle tombe généralement (mais reste dans les fleurs cléistogames et dans certains genres de la sous-famille tenace), et le calice reste toujours et grandit souvent (en particulier chez les espèces du genre Molucella, voir Fig. 215 et Hymenocrater). chez les fruits matures, les graines sont généralement absentes, moins souvent conservées, ce qui est une caractéristique primitive. L'endosperme le plus développé se trouve chez les espèces de la sous-famille australienne des Prostanteraceae et dans le genre Tetrachondra. L'enveloppe externe des lobes du fruit porte souvent des tubercules, des papilles ou des poils. , qui est associé à la méthode de leur distribution.
Selon les dernières données, la famille des Lamiacées compte environ 200 genres et 3 500 espèces, répartis presque partout dans le monde. Les lamiacées sont particulièrement nombreuses dans les pays à flore méditerranéenne ancienne - des îles Canaries à l'Himalaya occidental, où elles jouent souvent un rôle de premier plan dans les groupes végétaux. Les Lamiacées sont presque totalement absentes de l'Arctique et de l'Antarctique. Il y a très peu de Lamiacées dans la zone de la taïga. Les régions montagneuses des tropiques sont assez riches en Lamiacées, notamment centrales et Amérique du Sud. En Australie, les genres de la sous-famille des Prostanteraceae sont majoritairement endémiques à ce continent (6 genres et environ 100 espèces). La Nouvelle-Zélande est encore plus pauvre en Lamiacées, où il n'existe qu'une seule espèce de scutellaire et de menthe (toutes deux endémiques) et l'une des deux espèces est tout à fait unique. diverses sortes tetrachondra (la deuxième espèce se trouve en Patagonie). Le genre Tetrachondra est parfois classé comme une famille distincte. Les îles hawaïennes sont relativement riches en Lamiaceae, avec 2 genres endémiques de la sous-famille des Prasiaceae à prédominance tropicale.
Parmi les Lamiacées, les xérophytes des hautes et basses terres prédominent dans les habitats secs et ouverts, mais parmi elles, il existe également de nombreuses forêts mésophiles et plantes de prairie. Seules quelques espèces sont représentées dans les forêts tropicales humides. Réel plantes aquatiques pas du tout chez les Lamiacées, mais il en existe plusieurs genres, dont de nombreuses espèces vivent le long des berges des réservoirs et dans les marécages. Tels sont par exemple les genres très répandus menthe, zyuznik et scutellaire.
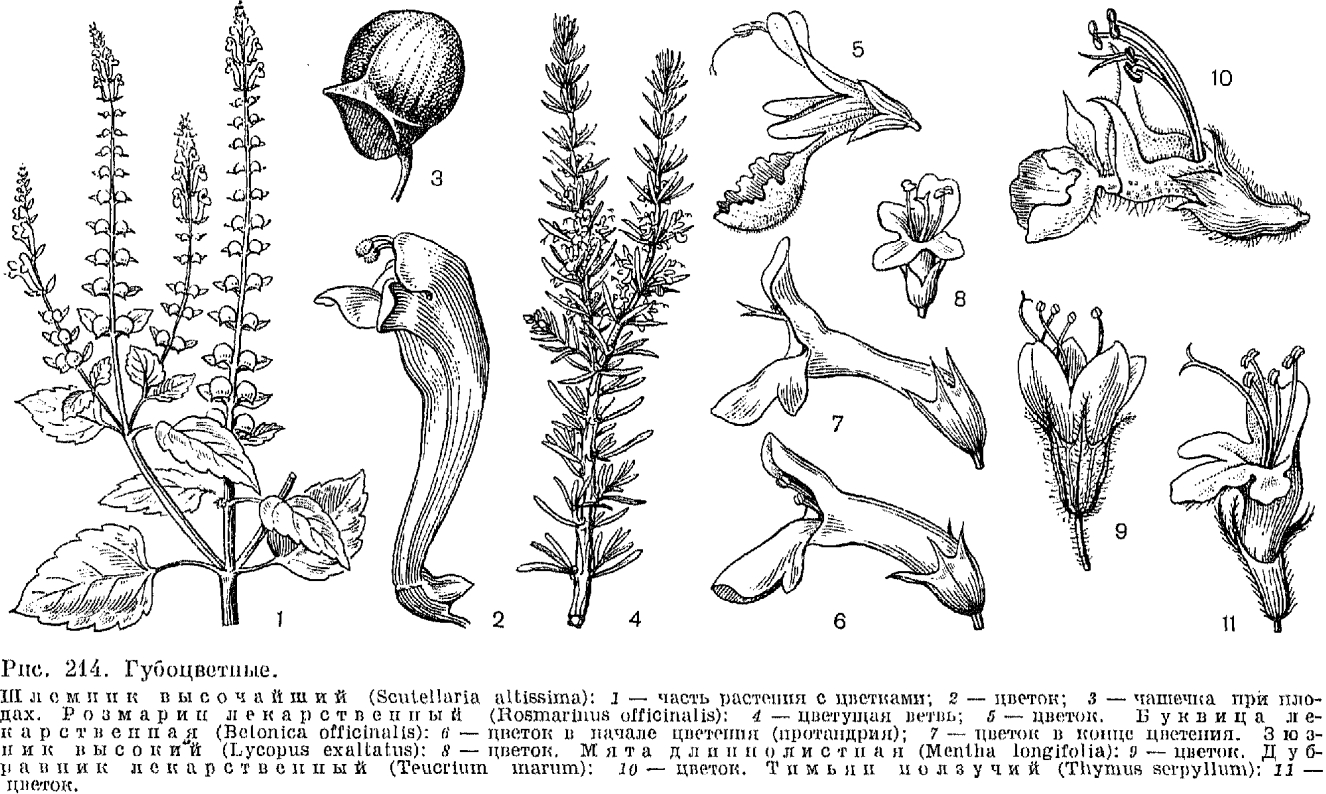 ,
, 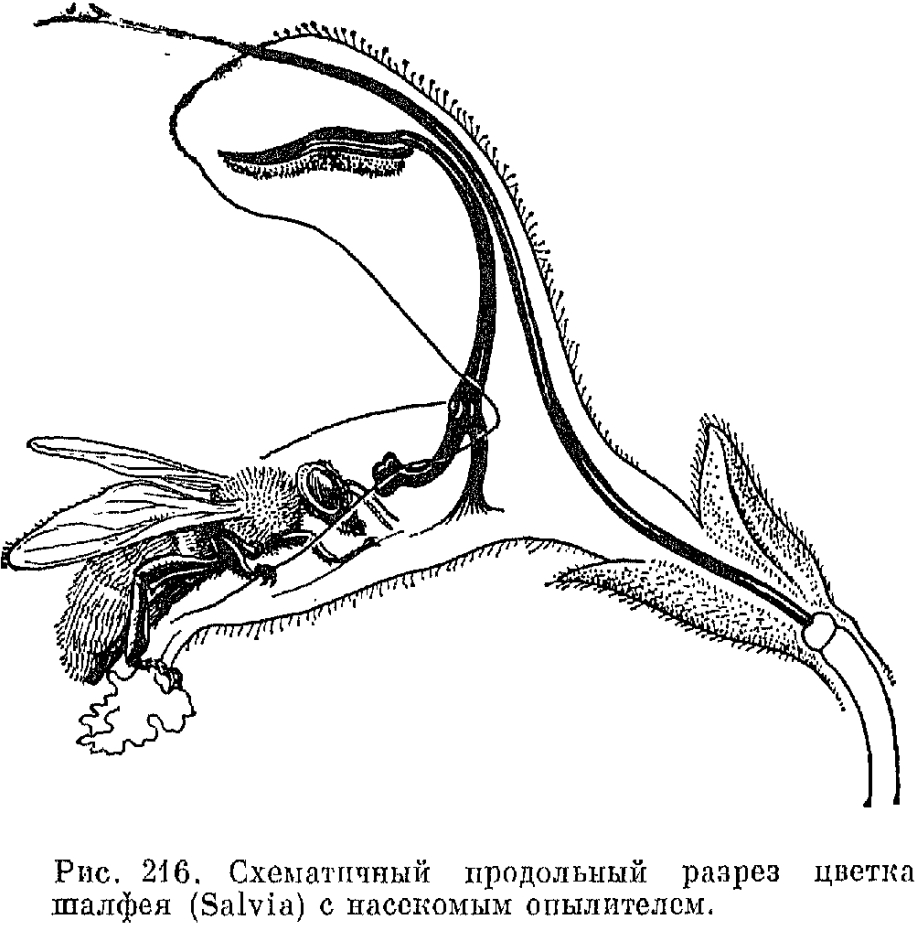
Les relations des Lamiacées avec leurs insectes pollinisateurs (et en Amérique tropicale et subtropicale également avec les colibris) sont très complexes et sont le résultat d'une longue évolution conjuguée. Les espèces des genres aux fleurs les plus simplement disposées, ayant une corolle presque régulière avec un tube court et 4 étamines de longueur presque égale (par exemple, la menthe, voir Fig. 214) sont généralement pollinisées par de petits hyménoptères et des mouches, puisque le nectar en eux sont facilement accessibles. Chez la plupart des autres Lamiacées à corolle à double lèvre bien définie, les étamines et le style sont adjacents à la lèvre supérieure, et le nectar est placé dans la partie inférieure d'un tube assez long. Les pollinisateurs de ces fleurs sont principalement des hyménoptères et des papillons, moins souvent de grosses mouches de la famille des syrphes. Les visiteurs d'une fleur touchent d'abord le stigmate, puis les anthères, et emportent une partie du pollen qui s'y trouve. Dans le fermoir et dans certains autres genres, la libération de pollen sur le dos de l'insecte est facilitée par la présence de poils orientés vers le bas sur les anthères, que l'insecte touche. Des dispositifs remarquables, comme un levier ou une barrière, qui permettent l'accès au nectar seulement après que le pollen a frappé le dos de l'insecte, se trouvent chez les espèces de sauge et de point noir (Prunella), mais ils atteignent la plus grande perfection chez les espèces de sauge, dans lesquelles les anthères des deux étamines existantes se transforment en une sorte de dispositifs à levier mobiles (voir ci-dessus). L'insecte pollinisateur, afin d'obtenir du nectar, enfonce sa tête dans le tube de la corolle, pousse le rudiment expansé en forme de cuillère du nid d'anthère inférieur vers l'intérieur et vers le haut, et le nid d'anthère fertile, situé à l'autre extrémité du conjonctif allongé, frappe le dos de l'insecte, déversant du pollen dessus (voir Fig. 216) . Les Lamiacées américaines des genres Salvia, Scutellaria, Monarda et autres ont souvent de grandes fleurs rouges pollinisées par de grands papillons de nuit et des colibris. Ces derniers, comme les papillons de la famille des sphinx, planent près des fleurs, sucent le nectar avec leur bec et touchent de la tête les stigmates et les étamines situées sous la lèvre supérieure ou dépassant de la corolle.
Chez certaines Lamiaceae (en particulier les genres de la sous-famille des Basilaceae), les étamines et le style sont placés sur la lèvre inférieure, de sorte qu'un insecte visitant la fleur (généralement un papillon) transporte le pollen jusqu'à la lèvre inférieure. la partie au fond abdomen Chez d'autres genres de Lamiacées, le même effet (position inférieure des étamines et du style) est obtenu grâce à la torsion du tube de la corolle (la lèvre supérieure devient comme une lèvre inférieure), à la torsion du pédoncule et à une inflorescence fortement tombante (par exemple , chez la sauge tombante - S. nutans, les inflorescences fleuries sont inversées de haut en bas). La possibilité d'autopollinisation des fleurs de Lamiacées est souvent éliminée en raison de plus maturation précoceétamines par rapport au stigmate (protandrie), mais dans de nombreux autres cas, l'autopollinisation est tout à fait possible. Il convient de noter que chez de nombreuses Lamiacées, non seulement la corolle, mais aussi d'autres parties de la fleur et de l'inflorescence participent à l'attraction des insectes et des oiseaux. Ainsi, la sauge brillante a des calices rouge vif et la sauge de chêne (S. nemorosa) a des bractées bleu-violet.
De nombreuses Lamiacées se propagent par le vent (anémochorie). Les unités de distribution - les diaspores - dans ce cas sont généralement des parties à graine unique d'un fruit fractionné, dont la dérive peut augmenter en raison de leur pilosité ou de la formation d'excroissances en forme d'aile ou de touffe. Ainsi, dans le genre Tinnea, répandu en Afrique tropicale, les fruits présentent des boucliers en forme de touffe. Chez les Lamiacées anémochores, les tiges restent souvent longtemps sèches, dispersant progressivement les fruits (même dans heure d'hiver). Dans d'autres cas, au contraire, les tiges ramifiées évasées aux inflorescences fruitières se cassent facilement à leur base et roulent sur la steppe avec le vent, dispersant progressivement les fruits. Ces tumbleweeds sont certains types de sauge, de zopnik, d'herbe à chat, etc. Plus les fruits ne tombent pas longtemps des tasses, plus la distance sur laquelle ils seront transportés est grande. Ainsi, de nombreuses Lamiacées possèdent des dispositifs permettant de maintenir les fruits dans le calice : un anneau de poils dans son pharynx ou des dents recourbées vers l'intérieur.
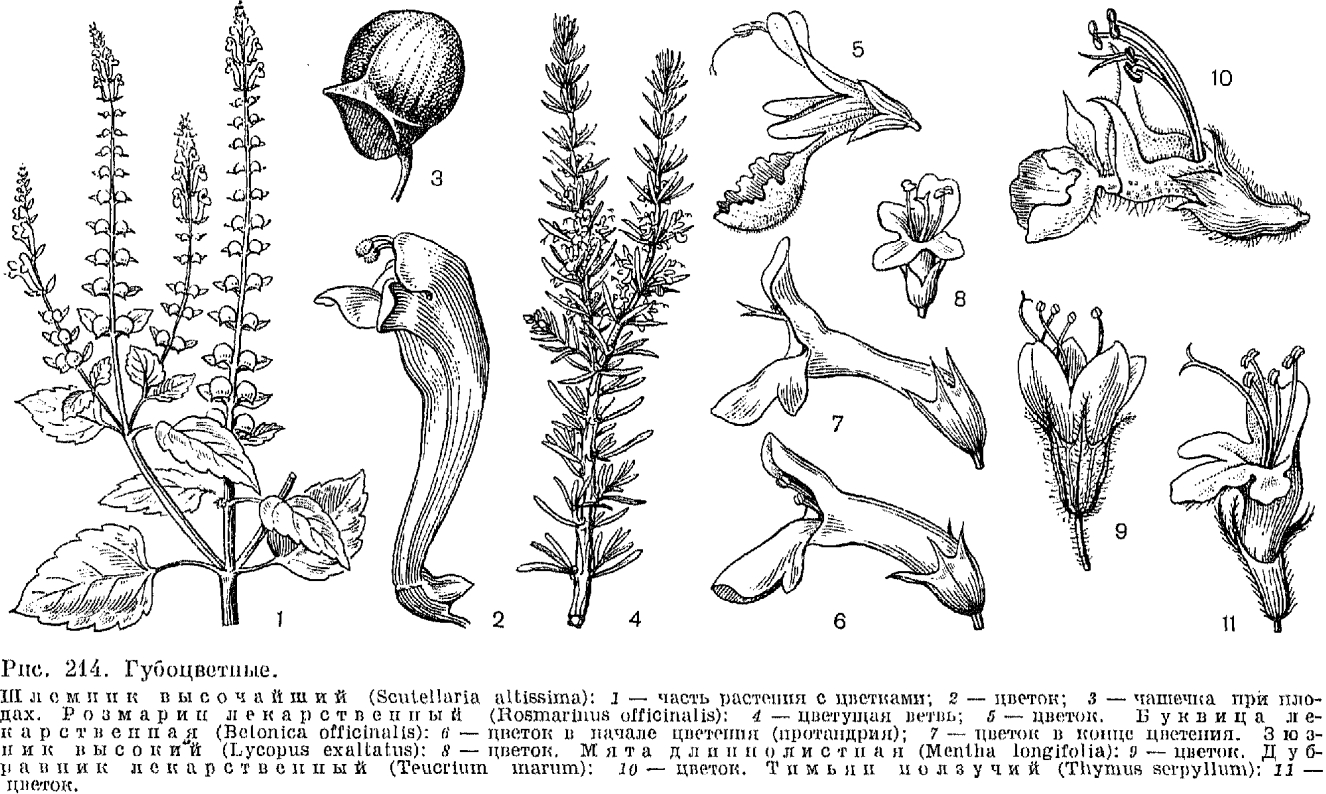
Chez de nombreuses Lamiacées anémochores, les lobes du fruit tombent avec le calice. Le vent dans ces cas est obtenu soit en raison de dents du calice relativement longues et souvent ciliées (par exemple, dans le thym - Thymus), soit en raison de la forte croissance du tube du calice et de ses dents. Ainsi, chez Molucella, le tube du calice pendant les fruits est considérablement élargi, membraneux et largement en forme de cloche (voir Fig. 214), tandis que chez le bec-de-lièvre, au contraire, les dents du calice augmentent considérablement en largeur.
Chez certaines espèces d'Otostegia, le rôle de la mouche est joué par la lèvre supérieure membraneuse fortement élargie du calice, et chez le saccocalyx algérien (Saccocalyx satureioides), le calice du fruit est gonflé en forme de bulle avec un pharynx fermé, qui permet aux fruits qu'ils contiennent d'être transportés par le vent sur de longues distances.
Parmi les Lamiacées, il existe de nombreuses espèces qui se propagent à l'aide d'animaux, et les adaptations à la zoochorie ne sont pas moins diverses. De nombreuses Lamiacées ont des membranes mucilagineuses des lobes des fruits lorsqu'elles sont mouillées et peuvent se propager à la fois par endozoochore (avec l'aide d'animaux frugivores, principalement des oiseaux) et par épizoochore (sur la laine et les plumes, ainsi que sur les pattes des animaux et des humains). Une plus grande efficacité de l'endozoochorie est obtenue grâce à la formation de fruits ressemblant à des drupes avec une coquille charnue juteuse (dans le genre méditerranéen Prasium). Dans le genre Hoslundia d'Amérique tropicale, le calice devient charnu (en forme de baie) lors de la fructification, dont la gorge est fermée par des dents. Les espèces à lobes de fruits adhésifs ou poilus se propagent de manière épizoochore. Dans de nombreux cas, la propagation épizoochorique est également facilitée par la chute des calices avec les fruits, les poils durs et les dents dures dépassant sur les côtés, qui constituent un excellent dispositif d'ancrage dans la fourrure animale.
Les fruits de certaines Lamiacées (en particulier les espèces de poissons tenaces et de demoiselles) ont des appendices disposés de diverses manières qui servent de nourriture aux fourmis. Ils se caractérisent par le mode de distribution dit myrmécochore. L'espèce brésilienne Glasio hiptis (N. glasiovii) appartient généralement aux plantes « aimant les fourmis » (myrmecophiles) : dans les entre-nœuds gonflés de ses tiges se trouvent constamment des colonies de fourmis spéciales.
Les espèces de Lamiacées qui vivent près des rives des plans d'eau et dans les marécages (par exemple, les espèces de menthe et de sauterelle) ont des lobes de fruits flottants, adaptés à la dispersion par les courants d'eau, mais en partie aussi par les animaux aquatiques.
Le système des Lamiacées est encore loin d’être parfait et est en cours de développement. Tout d’abord, la frontière qui sépare les Lamiacées de la famille des Verbénacées, étroitement apparentée mais plus primitive, n’est pas encore tout à fait claire. Ainsi, certains auteurs proposent de classer deux sous-familles de Lamiacées comme verveines, qui sont similaires dans la structure du gynécée à de nombreux genres de verveines - les prostantéracées et tenaces ; d'autres, au contraire, proposent de transférer une partie importante de la famille des verveines aux Lamiacées. Selon l'un des derniers systèmes de la famille des Lamiacées, développé par le botaniste allemand H. Melchior (1964), elle est divisée en 9 sous-familles. La première place parmi elles est occupée par la sous-famille australienne des Prostantheroideae, qui se distingue par la structure relativement primitive du gynécée et des graines avec endosperme, mais ayant une structure de périanthe assez hautement spécialisée. Vient ensuite la sous-famille tenace (Ajugoideae), qui possède un gynécée comme les prostantheridés, mais des graines sans endosperme. Ceux-ci incluent les genres tenaces, chênaie (Teucrium), amethystea (Amethystea), etc. Une sous-famille monotypique spéciale du romarin (Rosmarinoideae) comprend le genre romarin (Rosmarinus, tableau 55) avec une corolle prononcée à deux lèvres, 2 étamines et des graines sans endosperme (voir. Fig. 214).
, 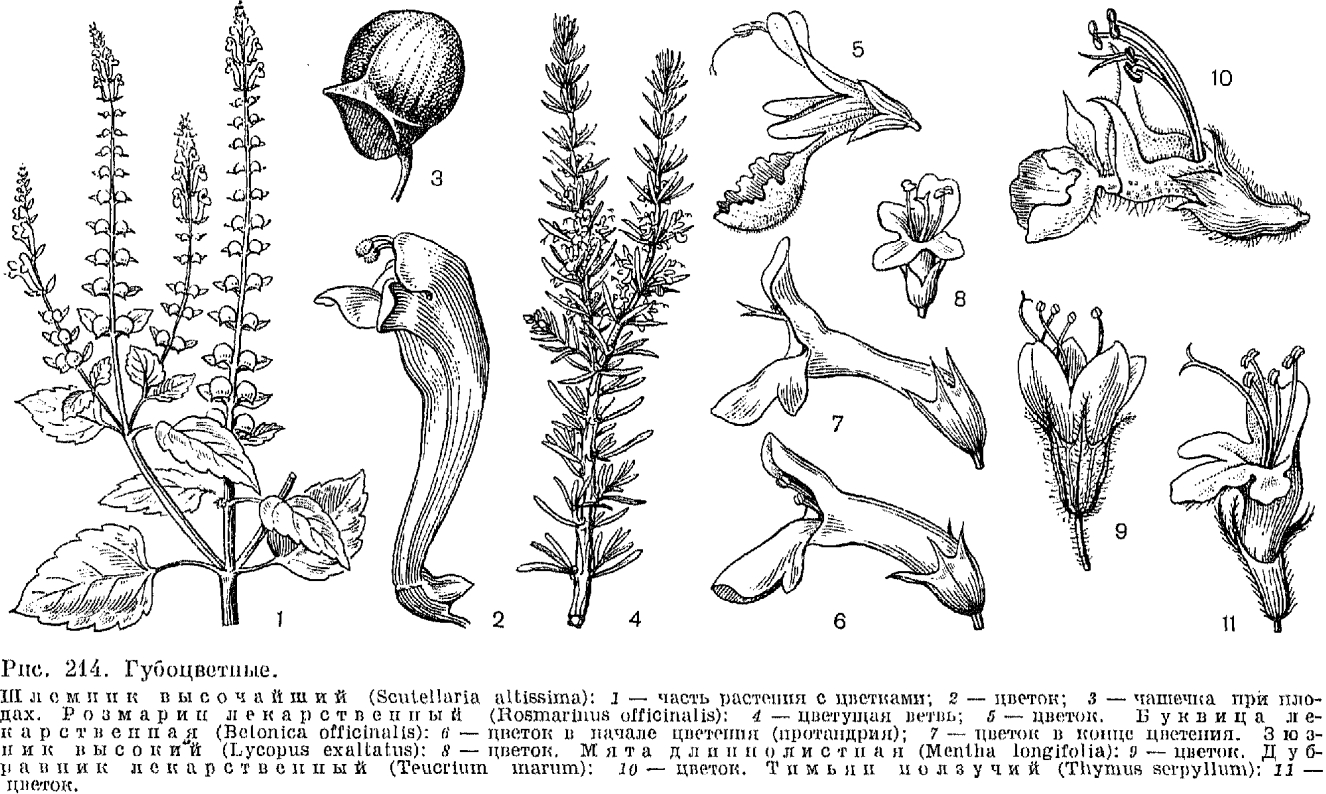
La sous-famille suivante, les basilaceae (Ocimoideae), comme toutes les sous-familles ultérieures, diffère des sous-familles précédentes par un gynécée plus spécialisé avec une colonne gynobasique clairement définie. Il y a 4 étamines, rarement 2. Les représentants de cette sous-famille sont répartis presque exclusivement dans les pays tropicaux et subtropicaux. Le plus grand genre, Hyptis, contient plus de 350 espèces, réparties principalement en Amérique du Sud et centrale. Ce genre comprend les arbres les plus hauts parmi les Lamiacées, poussant dans les forêts du Brésil. Le genre hiptis comprend deux espèces économiques types importants: H. spicigera, cultivée pour ses graines afin de produire une huile proche du sésame, et H. suaveolens, ou « sangura », qui produit une huile très aromatique thé médicinal. Le genre basilic (Ocimum) compte jusqu'à 150 espèces, réparties dans les pays tropicaux et subtropicaux, notamment en Afrique. Ce genre comprend le basilic noble (O. basilicum), originaire d'Asie tropicale, cultivé dans de nombreux pays, notamment dans le sud de l'URSS, ainsi que plante épicée. En Chine, la culture de cette plante est connue depuis 500 avant JC. e. Un autre représentant bien connu de ce genre est le basilic eugénolique (O. gratissimum) - un arbuste originaire d'Asie tropicale, cultivé notamment ici en Géorgie et dans les régions du sud. Région de Krasnodar comme plante à huile essentielle. Le basilic sacré (O. sanctum) est également célèbre - un arbuste paléotropical cultivé en Inde et dans d'autres pays comme plante cultivée. Le genre Plectranthus comprend environ 250 espèces réparties dans les pays tropicaux et subtropicaux de l'Ancien Monde. Un certain nombre d'espèces de ce genre atteignent le nord du Japon et régions du sud Extrême Orient. Mentionnons enfin le genre paléotropical Coleus (tableau 55, environ 150 espèces). Certaines espèces, notamment Coleus edulis (C. edulis), ont des racines féculentes et tubéreuses épaissies et sont cultivées comme plantes alimentaires sous les tropiques de l'Ancien Monde. De nombreuses espèces sont ornementales et certaines sont cultivées à l’intérieur et dans les jardins. L'espèce indo-malaise Coleus amboinicus (C. amboinicus) est utilisée comme assaisonnement alimentaire, et les écorces de l'indien Coleus vettiverioides (C. vettiverioides) sont utilisées pour diverses décorations. La sous-famille des Catopheriaceae (Catopherioideae) ne comprend qu'un seul genre de catopheria (Catopheria, 3 espèces), réparti du Mexique à la Colombie. Les types de catophérie sont des plantes d'apparence très originale, caractérisées par un embryon avec une racine succulente adjacente aux cotylédons.
La sous-famille de la lavande (Lavanduloideae) ne contient également qu'un seul genre de lavande (Lavandula). Le genre lavande, qui compte environ 28 espèces, est réparti principalement en Méditerranée et en Macaronésie, mais son aire de répartition s'étend jusqu'en Somalie en Afrique et en Inde. Cela inclut les sous-arbrisseaux et les arbustes. Certaines espèces sont utilisées depuis l’Antiquité pour obtenir de précieuses huiles essentielles. La lavande angustifolia (L. angustifolia) est un arbuste atteignant 1 m, et parfois jusqu'à 2 m de hauteur, largement cultivé pour obtenir de précieuses huiles essentielles et est également très apprécié comme plante ornementale. Les huiles essentielles sont également obtenues à partir de lavande à feuilles larges (L. latifolia) et de certaines autres espèces. Les fleurs et les feuilles séchées de lavande conservent longtemps un parfum épicé et sont utilisées pour éloigner les mites. La sous-famille suivante, Prasioideae, comprend 6 genres, répartis principalement en Asie tropicale. Seulement un genre monotypique Le prasium se trouve en Méditerranée, du Portugal à la Yougoslavie. Prasium, comme d'autres représentants de la sous-famille, se caractérise par des lobes de fruit en forme de drupe.
La grande majorité des Lamiaceae extratropicales appartiennent à la vaste sous-famille des Lamioideae, Melchior l'appelle Stachyoideae. Parmi les représentants de cette sous-famille, il convient de mentionner en premier lieu le genre Pogostemon, qui compte environ 40 espèces, réparties en Chine et en Asie tropicale. Ce genre comprend le patchouli (P. cablin), une plante très aromatique originaire des Philippines. Elle est largement cultivée dans les pays tropicaux pour son huile essentielle. L'huile de patchouli possède des propriétés bactéricides et est largement utilisée en parfumerie et en médecine. Les représentants utiles de la sous-famille comprennent également 5 espèces du genre Perilla (Perilla), commune en Asie du Sud, de l'Est et du Sud-Est. La périlla de brousse (P. frutescens) est cultivée en Asie de l'Est comme plante oléagineuse et médicinale, et la périlla frisée (P. frutescens var. crispa) au violet foncé, feuilles frisées Il est très décoratif et est cultivé en Chine et au Japon comme oléagineux, huile essentielle et salade. Plus valeur plus élevée possède un genre de menthe (Mentha, environ 25 espèces dans zone tempérée hémisphère nord, Afrique du Sud et Australie). Les fleurs des espèces de menthe sont presque actinomorphes, à quatre chaînons, avec 4 étamines presque identiques. Certains types de menthe, en particulier la menthe poivrée hybride (M. piperita), sont largement cultivés comme plantes médicinales et alimentaires précieuses (comme assaisonnement). Les huiles de menthe poivrée, qui contiennent, avec de nombreux autres composants, une quantité importante de menthol, sont ajoutées à de nombreux médicaments, dans les bonbons et dans dentifrice. L'hysope (Hyssopus officinalis) est également cultivée comme huile essentielle, plante médicinale et ornementale. Les espèces du genre Origanum (Origanum) revêtent également une certaine importance. Environ 15 à 20 espèces de ce genre sont connues, réparties en Europe, dans les régions méditerranéennes et tempérées d'Asie. L'origan (O. vulgare) est utilisé comme plante médicinale, et les feuilles sont utilisées comme épice et assaisonnement pour l'alimentation et dans l'industrie de la distillerie. La marjolaine (O. majorana) est largement cultivée et, avec plusieurs espèces apparentées, est parfois classée comme un genre distinct Majorana. La patrie de la marjolaine est l’Asie du Sud-Ouest et l’Afrique du Nord. Les feuilles de marjolaine sont utilisées comme épice pour divers plats et pour ajouter de la saveur au vinaigre et au thé. L'huile essentielle est extraite des feuilles et des fleurs. Un des plus représentants célèbres La famille est constituée du genre Thym (Thymus), qui compte de 35 à 400 espèces, selon le point de vue du taxonomiste sur la taille de l'espèce. Les feuilles de thym contiennent des huiles essentielles, principalement du thymol, utilisées en médecine. Les feuilles sont utilisées comme épice dans les industries des conserves et des boissons alcoolisées. Le thym méditerranéen (T. vulgaris) est largement cultivé dans les pays tempérés et tropicaux. Des espèces du genre Melissa (Melissa, 5 espèces en Eurasie) sont également utilisées. La mélisse officinalis, ou mélisse (M. officinalis), est cultivée comme plante à huile essentielle, mellifère et épicée. Proche de la mélisse se trouve le genre sarriette (Satureja), qui compte jusqu'à 200 espèces, commune dans les régions tempérées et subtropicales. La sarriette (S. hortensis) est cultivée comme plante à huile essentielle. Il est utilisé comme épice, en médecine et en parfumerie, ainsi que pour aromatiser les liqueurs et les cognacs. Enfin, la sarriette des montagnes (S. montana) est cultivée comme plante ornementale.
Stachys est l'un des grands genres de la sous-famille, comptant environ 300 espèces, réparties dans les régions tempérées, subtropicales et tropicales, mais absentes toutefois en Australie et en Nouvelle-Zélande. Certaines espèces de chistets jouent un rôle notable dans la composition du couvert végétal (tableau 55). Du numéro espèces utiles il convient de mentionner l'artichaut dit chinois (S. affinis), introduit dans la culture en Chine et actuellement également élevé au Japon, en Belgique et en France comme plante potagère pour le bien des rhizomes tubéreux comestibles. Plusieurs espèces de chistema sont cultivées comme plantes ornementales.
La sauge est le plus grand genre de la famille des Lamiacées. Le nombre d’espèces de sauge atteint 700 et elles sont largement réparties dans les régions tempérées, subtropicales et tropicales. Certaines espèces de sauge jouent un rôle prédominant dans le couvert végétal. La Salvia officinalis (S. officinalis) est largement cultivée et bien connue de tous. Très populaire plante ornementale les jardins et les parcs sont devenus la sauge brillante brésilienne avec une coupe et une corolle rouge vif. L'espèce mexicaine de sauge narcotique (S. divinorum) contient des substances ayant un effet narcotique, connues des anciens Mexicains. Au Pérou, la sauge oppositiflora, un arbuste aux fleurs rouges de 2,5 à 3 cm de long, était considérée comme une fleur sacrée.
Parmi les autres représentants médicinaux de cette sous-famille, nous mentionnons également l'agripaume (Leonurus hearta) - un remède cardiaque bien connu, l'encensoir (Melittis melissophyllum), les espèces de ziziphora (Ziziphora), le bec-de-lièvre.
La dernière place du système Melchior est occupée par la sous-famille des Scutellarioideae, la plus spécialisée dans la structure des fleurs. Cette sous-famille ne comprend que deux genres : le grand genre Scutellaria, comptant environ 300 espèces, très largement réparties dans le monde (à l'exception de l'Afrique du Sud), et le genre monotine Salazaria, distribué aux États-Unis et au Mexique.
Plus naturel par rapport au système Melchior est le système des Lamiaceae, proposé en 1967 par R. Wunderlich. Elle repose principalement sur la structure des fruits et des grains de pollen, et sur Dernièrement est également confirmé par les données de chimiotaxonomie. Wunderlich n'accepte que 6 sous-familles : Prostateraceae, Tenacious, Scutellariaceae, Chestaceae, Savoury (Saturejoideae) et Catopheriaceae. Elle combine la sous-famille des Prasiaceae Melchior avec les Chistetsaceae, et les sous-familles Rosemaryaceae et Lavenderaceae avec la sous-famille savoureuse qu'elle distingue des Chistetaceae. Les basilacées de Melchior rejoignent également la famille des sarriettes Wunderlich, mais occupent une place à part dans cette sous-famille. Bien que le système phylogénétique de Wunderlich présente plusieurs avantages, il subira sans aucun doute d’autres changements.
Vie des plantes : en 6 volumes. - M. : Lumières. Edité par A. L. Takhtadzhyan, rédacteur en chef, membre correspondant. Académie des sciences de l'URSS, prof. Les AA Fedorov. 1974 .
Lamiaceae (Lamiaceae), Lamiaceae (Labiatae), famille des régions fleuries dicotylédones. Plantes herbacées annuelles et vivaces, sous-arbustes, arbustes, parfois lianes et petits arbres. Les feuilles sont opposées ou verticillées, simples, sans stipules. Les fleurs sont bisexuées, irrégulières, souvent bisexuées
Dans notre article, nous voulons parler de la famille des Lamiacées. Selon les dernières données, il existe environ deux cents genres, soit 3 500 espèces. Ils sont distribués presque partout dans le monde. Ils ne poussent pas uniquement en Antarctique et dans l’Arctique. Ils sont peu nombreux dans la zone de la taïga, ils préfèrent les zones montagneuses tropicales. La famille des Lamiacées est un représentant très particulier de la flore. Les plantes qui en font partie sont intéressantes avant tout comme fournisseurs de matières premières médicinales d'origine naturelle.
Apparition des plantes
Les plantes appartenant à la famille des Lamiacées ont une structure d'apparence caractéristique. Ils sont très faciles à reconnaître grâce à la fleur, qui possède un long tube et un pharynx à deux lèvres, rappelant une bouche ouverte. créature de conte de fées. Tel poinçonner n'a que la famille des Lamiacées. Une inflorescence de ce type n'est pratiquement pas trouvée chez d'autres plantes.
Quant aux fruits, ils ont aussi forme inhabituelle. Le fruit de la famille des Lamiacées se compose de quatre lobules à une seule graine en forme de noix.
Aussi trait distinctif est la disposition opposée des feuilles entières. Les tiges ont généralement une forme tétraédrique. Les caractéristiques de la famille des Lamiacées seraient incomplètes sans mentionner arôme fort, ce qui est caractéristique d'un plus grand nombre de plantes. L'arôme phénoménal est dû à la présence de Différents composants glandes végétales qui sécrètent des huiles essentielles complexes. C'est en raison de la présence de ces huiles que les plantes de la famille des Lamiacées sont largement utilisées comme médicinales, aromatiques, et nous parlerons ci-dessous des plus courantes d'entre elles.
Famille des Lamiacées : représentants
Les représentants de cette famille sont très divers. La plupart d’entre eux sont des arbustes et des herbes. Cependant, dans les régions subtropicales et tropicales, les arbustes sont très courants. Un représentant éminent est le romarin médicinal, répandu en Méditerranée. C'est un arbuste persistant avec de petites feuilles linéaires et des fleurs violettes. 
La famille des Lamiacées (photo donnée dans l'article) est également représentée par des arbres, mais on ne les trouve que sous les tropiques. Certains d'entre eux atteignent une hauteur de quinze mètres. Mais, en règle générale, les Lamiacées ligneuses ne dépassent pas cinq mètres.
Lamiacées herbacées
La graminée de la famille des Lamiacées est une plante dressée et ne nécessite pas de support. Cependant, il existe également des espèces rampantes (par exemple, le budra en forme de lierre). Et une telle plante a non seulement des pousses dressées, mais aussi des pousses arquées qui poussent à l'aisselle des feuilles, s'enracinant dans le sol avec leurs pointes (comme les vrilles d'une fraise).
Système racinaire
Les plantes conservent leur racine pivotante tout au long de leur vie. Parfois, il arrive qu'il meurt et soit remplacé par des racines adventives qui s'étendent de la tige elle-même ou de ses pousses rampantes. Les rhizomes sont caractéristiques de plus Lamiacées.
Beaucoup moins courantes sont les plantes à drageons, comme celles des variétés côtières poussant sur des sols gorgés d'eau, parfois les racines ressemblent à des tubercules, dont les résidents locaux se nourrissent.
Structure des feuilles
Les représentants de la famille ont généralement des feuilles entières, parfois entières. Mais il existe parfois des espèces nues, comme la sauge décorative. Dans ce cas, la plante est recouverte d'une épaisse couche de poils (chistets crétois, ironweed de Crimée).
Fleurs de Lamiacées
Comme nous l'avons noté plus tôt, structure spéciale Ils ont aussi des fleurs. La famille des Lamiacées se caractérise par le fait que ces dernières sont généralement bisexuelles. Ils sont situés à l'aisselle des feuilles. Seules quelques espèces ont des fleurs simples. Le plus souvent, ils sont rassemblés en inflorescences de deux, qui forment ce qu'on appelle des épillets. Certaines variétés ont même des épines conçues pour empêcher la plante d'être mangée par les animaux. De telles espèces se trouvent dans les régions montagneuses d’Asie centrale (lièvres). 
En règle générale, le calice et la corolle des Lamiacées sont constitués de cinq folioles fusionnées en un tube. En général, la tasse peut être la plus différentes formes: en forme de cloche, tubulaire, en forme d'entonnoir, sphérique. Ses modifications sont associées à une tentative d'adaptation à la répartition des fruits. Le calice peut changer de couleur, devenir très brillant, pour attirer l'attention des oiseaux et des animaux, et peut croître, augmentant ainsi la dérive, pour répandre les graines par le vent.
La famille des Lamiacées est composée de plantes qui possèdent quatre étamines dans chaque fleur, attachées à un tube de corolle. Quelques espèce tropicale les étamines grandissent ensemble. En dessous de leur emplacement se trouve un anneau poilu conçu pour protéger le nectar.
Les anthères des Lamiacées peuvent se présenter sous différentes formes. Tout dépend du degré d'adaptation de la plante à la pollinisation. Il existe parfois de véritables « mécanismes » complexes, comme ceux de la chauve-souris de fer et de la calotte.
Bien que les fleurs bisexuées soient plus typiques des Lamiacées, de nombreux représentants ont également des fleurs femelles avec des étamines. Il est beaucoup moins courant de voir des fleurs mâles. Un exemple d'une telle plante est plante herbacée de la famille des Lamiacées, mauvaise herbe.
Fruit
La famille des Lamiacées, dont nous considérons les représentants, se distingue par le fait que toutes les plantes ont une structure fruitière caractéristique. En règle générale, il se compose de quatre lobes contenant chacun une graine. La forme du fruit lui-même peut être très différente. La corolle tombe généralement pendant la fructification, mais le calice reste et grandit certainement. Les graines matures manquent d’endosperme.
L'enveloppe externe des lobes est souvent grumeleuse, ce qui facilite la dispersion des graines.
Lieux de croissance
Les représentants de ce type de flore, comme la famille des Lamiacées (Lamiaceae), sont répartis dans le monde entier. On en trouve surtout beaucoup dans les pays à flore méditerranéenne (des îles Canaries à l'Himalaya occidental). Mais dans la taïga, de telles plantes n'existent pratiquement pas. Les zones montagneuses tropicales sont un paradis pour les Lamiacées. Ils sont particulièrement nombreux en Amérique du Sud et en Amérique centrale. En Australie, on ne trouve que des espèces endémiques de ce continent, soit une centaine d'espèces au total. La Nouvelle-Zélande est encore plus pauvre, avec une seule espèce de menthe et une espèce de scutellaire, ainsi qu'un représentant du genre Tetrachondra. Mais sur les îles hawaïennes il y a pas mal de Lamiacées, elles sont représentées par deux genres endémiques. 
Les plantes de cette famille préfèrent pousser dans les zones de montagne ou de plaine. Les sols plus secs leur conviennent. Parmi eux, il y a très peu de prairies et plantes forestières. Seuls quelques représentants sont capables de survivre dans les forêts tropicales humides, car les Lamiacées ne peuvent être tolérées. excès d'humidité. Quant aux véritables espèces aquatiques, elles n’existent pas du tout dans la nature. Il n'existe que quelques genres, dont certaines espèces poussent au bord des marécages et des étangs. Un exemple est la plante herbacée vivace de la famille des Lamiacées - la menthe, ainsi que la scutellaire et la sauge.
Pollinisation des plantes par les insectes
La relation entre les Lamiacées et les insectes qui les pollinisent est assez complexe et est le résultat d'un long processus d'évolution. Les plantes de cette famille qui ont les fleurs disposées les plus simplement sont pollinisées par les mouches et les hyménoptères, car il n'est pas particulièrement difficile d'en obtenir du nectar. 
Chez les Lamiacées, qui ont un nectar plus complexe, il n’est pas si facile à obtenir. Il est situé au fond d'un long tube. La pollinisation de ces espèces est réalisée par des papillons et des hyménoptères, et très rarement par de grands syrphes.
Sage possède un dispositif unique sous la forme d'un levier qui permet aux insectes d'atteindre le nectar. Les insectes doivent s’ingénier pour obtenir ce pour quoi ils sont venus. Dans les régions subtropicales et tropicales d'Amérique, les plantes sont pollinisées par de petits colibris. Les papillons de la famille des sphinx agissent de la même manière que les colibris. Ils planent autour des fleurs et sucent en même temps le nectar avec leur bec, touchant les étamines avec leur tête.
Certaines plantes de la famille des Lamiacées ont une structure florale telle qu'un insecte, assis dessus, attrape le pollen avec son abdomen puis l'emporte. Des variétés très rares peuvent s’autopolliniser.
Je voudrais noter que les Lamiacées ont leur propre façon d'attirer l'attention des insectes, par exemple sous la forme de parties lumineuses séparées de la fleur.
Adaptabilité des plantes à se propager
Quant à la reproduction, la grande majorité se propage par le vent. Le processus lui-même implique les lobes du fruit à graine unique, dont la dérive est augmentée en raison de poils ou d'excroissances en forme d'ailes. Le genre Tinneya est très répandu en Afrique. Ainsi, ses fruits sont armés de boucliers en forme de touffes, qui facilitent la propagation des graines. 
Quelques variétés pendant longtemps Ils maintiennent les tiges au sec et les graines se dispersent progressivement sous l'influence des vents. Pour d'autres, au contraire, ils se détachent très vite au sol et sont emportés par les vents à travers les steppes, dispersant les fruits. Cet effet tumbleweed est caractéristique de certaines variétés de sauge, d’herbe à chat et de zopnik. Plus les fruits restent longtemps dans la tasse, plus ils seront transportés loin. C’est pour cette raison que de nombreuses Lamiacées disposent de mécanismes fiables pour retenir les graines.
D'autres types, au contraire, sont conçus de telle manière que le fruit tombe avec le calice et, de ce fait, présente un vent important, ce qui lui permet de se propager sur de longues distances.
Parmi les Lamiacées, il existe de nombreuses plantes qui se propagent grâce à des êtres vivants. En même temps, ils disposent d'appareils non moins intéressants qui les aident dans ce domaine. Certains d'entre eux sont mangés par les oiseaux et les animaux, d'autres s'accrochent à leur fourrure et à leurs vêtements humains avec leurs pousses. Chaque espèce a trouvé son propre chemin de distribution.
Sous les tropiques, certains fruits sont recouverts d'une coquille charnue (en forme de baie) qui attire les animaux et les oiseaux, tandis que d'autres sont enduits d'une substance adhésive qui leur permet de coller à la fourrure ou au plumage. 
Mais l’adaptabilité de certaines espèces à la répartition est absolument étonnante. Par exemple, certaines variétés de demoiselles et tenaces contiennent des substances qui servent de nourriture aux fourmis, et c'est avec leur aide que les fruits se propagent. La plante hiptis brésilienne est conçue de telle manière que des colonies de fourmis vivent toujours dans ses entre-nœuds.
Les Lamiacées qui ont choisi comme habitat les côtes des rivières et des marécages ont des parties flottantes de leurs fruits, et donc propagées par l'eau, parfois avec l'aide d'animaux.
Application
Herbe, arbuste, liane, sous-arbrisseau de la famille des Lamiacées, ce sont autant de formes diverses de la même famille. Beaucoup d’entre elles sont des cultures oléagineuses essentielles et présentent donc un intérêt particulier pour l’homme. Ces plantes comprennent : le basilic, la sauge, le marrube, Dubrovnik, le romarin, la lavande.
La lavande est un sous-arbuste de la famille des Lamiacées. Plus de vingt-cinq espèces en sont connues. Dans de nombreux pays, il est cultivé exclusivement pour son huile essentielle unique. Et certains types de ceci plante intéressante sont intéressantes comme plante mellifère médicinale décorative.
Le basilic fait également partie des plantes arbustives et semi-arbustives. Environ 150 de ses espèces poussent dans les régions subtropicales et tropicales, certaines d'entre elles produisent une huile essentielle précieuse. De plus, le basilic est largement utilisé comme assaisonnement dans de nombreuses cuisines du monde entier. 
La célèbre sauge possède également de nombreuses variétés, dont certaines sont des plantes mellifères et une source de huile aromatique. En Russie, il est courant dans la zone steppique.
Perilla est un représentant des Lamiacées annuelles. Il s’agit d’une culture exclusivement oléagineuse. Il est cultivé en Asie, au Japon, en Chine et en Corée du Nord, et même en Extrême-Orient. L'huile comestible et technique est obtenue à partir des graines. De plus, certaines espèces ont usage décoratif, et sont également d’excellentes plantes mellifères.
Plantes médicinales de la famille des Lamiacées
Depuis l’Antiquité, les Lamiacées sont appréciées des hommes pour leur propriétés médicales. Et maintenant, leurs substances curatives sont activement utilisées. Dans nos régions, les variétés les plus connues sont : la menthe, l'agripaume, la sauge, la sauge, etc.
La sauge n'est pas seulement mais aussi une plante médicinale de la famille des Lamiacées. Il est activement utilisé pour l'irrigation et le rinçage de la gorge et de la bouche.
Le basilic est bon contre la perte d’appétit, la constipation et les flatulences. Parfois, il est utilisé comme gargarisme ou comme compresse pour les plaies purulentes. 
L'origan est également une plante médicinale de la famille des Lamiacées, utilisée pour soigner les maladies intestinales et gastriques, ainsi que les bronchites. Il convient de noter que c'est l'huile d'origan qui fait partie de nombreuses pommades à friction, bonnes pour les rhumatismes. La plante est également utilisée comme épice, par exemple dans la cuisine italienne pour confectionner la célèbre pizza. L'huile essentielle de cette plante est merveilleuse. Et dans la médecine indienne, l'origan est utilisé non seulement pour traiter les maladies de l'estomac, mais aussi pour les troubles nerveux.
Familier depuis l'enfance menthe poivrée fait partie de nombreux mélanges de thés qui aident à traiter le foie, la vésicule biliaire, les intestins et l'estomac. En général, on le retrouve dans de nombreuses collections. De plus, à la maison, il est infusé comme un simple thé, car la boisson est très aromatique, agréable et a un effet sédatif.
Le Dubrovnik commun est utilisé comme médicament pour l'estomac pour les maladies de la vésicule biliaire et des intestins. De plus, il a la capacité de stimuler l’appétit et aide à lutter contre la bronchite.
La marjolaine nous est familière comme assaisonnement. Il améliore l'appétit en stimulant la formation de bile et de suc gastrique. Sa teinture a un effet antiseptique, antispasmodique, diurétique et tonique général. La marjolaine est utilisée pour traiter la gastrite et la cholécystite chronique, les flatulences et les maux de tête, les troubles du cycle, l'insomnie et les vomissements.
Pikulnik est bon pour la toux et diverses maladies pulmonaires. De plus, il possède des propriétés purificatrices du sang et est utilisé pour les maladies de la vésicule biliaire et du foie.
Le thé aux reins est un excellent diurétique largement utilisé pour les maladies des voies urinaires.
La sarriette a un effet bénéfique sur l'estomac, favorisant la sécrétion de jus, elle est donc utilisée pour stimuler l'appétit. Infusée sous forme de thé, elle est utilisée contre l'écoulement nasal et la toux. 
Le thym est utilisé en médecine comme expectorant.
Dans l’article, nous avons parlé uniquement de quelques plantes médicinales de la famille des Lamiacées. En fait, ils sont tellement nombreux qu’il est impossible de tous les décrire. Mais le fait qu'ils aident réellement à lutter contre divers types de maladies est démontré par la pratique à long terme de leur utilisation dans différents pays paix.
Les Lamiacées sont autour de nous
Je voudrais souligner que les plantes de la famille des Lamiacées poussent non seulement dans des conditions faune. Vous serez surpris, mais parmi les plantes cultivées dans nos parterres, il y a pas mal de représentants de ce groupe, par exemple les mêmes salvias qui nous ravissent par leur fleurs lumineuses avant l'arrivée du gel.
De plus, certaines fleurs qui poussent sur les rebords des fenêtres de nos appartements sont également des Lamiacées : coleus, lierre suédois, arbre à papillons. Les femmes au foyer les aiment depuis longtemps pour leur simplicité et couleur vive. Ils n'ont pas besoin soin particulier, mais ils ravissent toujours par leur beauté. DANS période estivale les plantes poussent bien sur le balcon et en hiver dans l'appartement. Ils préfèrent éclairage lumineux, ils doivent donc être placés du côté sud.
Quant à l’arrosage, il ne doit pas être très fréquent. Et en période hivernale plutôt rare. Comme nous l'avons dit plus tôt, les Lamiacées ne tolèrent pas l'excès d'humidité, et cela s'applique également aux représentants domestiques. 
Récemment, une plante comme le romarin est devenue très à la mode. Il n'est pas seulement utilisé comme assaisonnement, mais également cultivé à la maison. C'est vrai, la plante n'aime pas hautes températures et air sec chauffage central(il peut même perdre des feuilles et commencer à se dessécher). Il a un bon aspect décoratif ; il devient particulièrement intéressant lors de la floraison, lorsqu'il est entièrement recouvert de petites fleurs bleues ou bleu clair. En été, certaines femmes au foyer plantent même de telles plantes d'intérieur terrain ouvert, ils s'y sentent bien. Mais avant l'arrivée du froid, le romarin doit être ramené à la maison, car il ne tolérera pas le gel. Cette culture est bonne pour un usage domestique non seulement parce que aspect décoratif. La plante dégage un arôme agréable, purifiant l'air, car elle possède des propriétés bactéricides.
Au lieu d'une postface
Parmi les plantes qui nous entourent Vie courante, un bon nombre appartiennent à la famille des Lamiacées. Comme nous l’avons vu, ils décorent non seulement nos maisons et nos parterres de fleurs, mais sont également largement utilisés en médecine et en parfumerie. Mais nous ne pensions même pas à l’existence de beaucoup d’entre eux, et encore moins savions qu’ils appartenaient à une si grande famille.
Famille des Lamiacées (LAMIACEAE)
Les représentants de cette famille sont facilement reconnaissables à la structure de la corolle des fleurs, qui possède un long tube et un pharynx à deux lèvres, rappelant la gueule béante d'un animal de conte de fées. Bien qu'une corolle d'aspect similaire soit présente dans plusieurs autres familles de plantes à fleurs (par exemple chez de nombreuses Norichacées), elle est particulièrement caractéristique des Lamiacées. Non moins unique est le fruit des Lamiaceae, constitué de 4 lobes à une seule graine en forme de noix ou rarement en forme de drupe, tandis que chez les Norichineaceae, dont la structure de la corolle est similaire, le fruit est généralement une capsule à plusieurs graines. Les caractéristiques distinctives importantes des Lamiacées comprennent également des feuilles opposées (très rarement verticillées), généralement entières sans stipules et des tiges généralement tétraédriques. L'odeur aromatique caractéristique de la plupart des espèces de Lamiaceae est très importante, qui est déterminée par la présence sur tout ou partie de la plante de glandes qui sécrètent des huiles essentielles de composition complexe (elles comprennent des alcools aromatiques, des phénols, des terpènes, des aldéhydes et d'autres substances organiques). composés). C'est la présence de ces huiles qui détermine en grande partie l'utilisation pratique des Lamiacées comme plantes techniques, médicinales et aromatiques.
La plupart des Lamiacées sont des herbes et des arbustes. Cependant, parmi eux, notamment dans les zones tropicales et subtropicales, il existe de nombreux arbustes, dont un exemple est le romarin (Rosmarinus officinalis), répandu dans la région floristique méditerranéenne, un arbuste à feuilles persistantes avec de petites feuilles linéaires et bleu-violet (à presque blanches). ) fleurs. Lamiacées - les arbres ne se trouvent que sous les tropiques, mais, contrairement à la famille étroitement apparentée des Verbenaceae, à prédominance ligneuse, ils ne constituent que quelques espèces de deux genres américains : Hyptis et Leucosceptrum. Parmi elles, la « championne » en hauteur est l'espèce brésilienne Hyptis membranacea (H. membranacea), qui atteint une hauteur de 12 à 15 m, tandis que d'autres Lamiacées ligneuses n'atteignent généralement pas une hauteur de 5 m. Sous les tropiques, il existe également un quelques vignes auxquelles appartiennent uniquement le genre américain Salazaria, certaines espèces de scutellaire (Scutellaria) et le genre hawaïen Stenogyne.
Les tiges des Lamiacées herbacées sont généralement dressées et ne nécessitent pas de support, bien qu'il existe des espèces dont les tiges rampent sur le sol et s'enracinent dans les nœuds (par exemple, bourgeon à feuilles de lierre - Glechoma hederacea). Chez la plante grimpante rampante (Ajuga reptans), en plus des pousses reproductrices dressées, à l'aisselle des feuilles de la rosette, se forment des pousses végétatives arquées dirigées vers le sol et enracinées au sommet, semblables aux vrilles du fraisier. Une rosette bien développée de feuilles basales, qui est préservée pendant la croissance des plantes, se trouve chez de nombreuses Lamiacées herbacées (par exemple, chez certaines sauges - Salvia). La racine principale reste souvent tout au long de la vie de la plante, moins souvent elle meurt et est remplacée par des racines adventives s'étendant soit à partir de la base de la tige, soit à partir de pousses souterraines rampantes qui en partent - des rhizomes, caractéristiques de nombreuses espèces de Lamiacées. Assez rarement parmi les Lamiacées, on trouve des espèces à drageons, par exemple le tenace de Genève (Ajuga gennevensis). Chez de nombreuses espèces côtières qui vivent dans des habitats gorgés d’eau, des cavités aériennes ou des zones de tissus aériens se forment dans les rhizomes. Certaines Lamiacées ont des racines tubéreuses et épaissies, qui sont utilisées comme aliment dans les pays tropicaux. Avec des feuilles opposées, les paires proches alternent transversalement les unes avec les autres. La conséquence en est la nature tétraédrique des tiges des Lamiacées, et les bords peuvent être plats, convexes ou concaves. Parmi les Lamiacées, il existe peu d’espèces à feuilles verticillées. Il s'agit notamment de l'arbuste australien original Westringia, avec de petites feuilles entières disposées en verticilles de 3 à 6. Une disposition régulière des feuilles n'a été observée que dans les premières feuilles des semis des genres Phlomis et Betonica.
Les feuilles des Lamiaceae sont généralement entières et souvent entières, bien que l'on trouve également des feuilles pennées divisées (par exemple chez Salvia scabiosifolia). On connaît aussi bien des espèces glabres ou presque glabres, comme la sauge ornementale (S. splendens), que des espèces densément couvertes de poils. Parmi ces dernières, des espèces méditerranéennes telles que le mouron crétois (Stachys cretica) et l'ironweed de Crimée (Sideritis taurica) ne sont pas inférieures en beauté au célèbre edelweiss alpin. Parmi les poils, les plus courants sont les poils simples multicellulaires. Les poils capités, dont la tête fonctionne comme une glande produisant de l'huile essentielle, se trouvent chez de nombreuses Lamiacées. En règle générale, les fleurs à cinq chaînons et, en règle générale, bisexuées des Lamiacées sont situées à l'aisselle des feuilles qui sont inchangées ou modifiées en bractées. Ce n'est que dans quelques cas (par exemple chez les espèces de scutellaire) qu'elles sont solitaires ; généralement les fleurs forment ce qu'on appelle de faux verticilles, composés de deux inflorescences opposées portant des bractées. Les axes de toutes les inflorescences primaires, souvent considérablement raccourcis, et leurs fleurs constitutives semblent être situées directement à l'aisselle des feuilles, formant des inflorescences en forme d'épi. Parfois, l'axe de l'inflorescence générale est considérablement raccourci et l'inflorescence entière devient capitée, par exemple chez Ziziphora capitata et dans le grand genre américain hiptis. Chez le bec-de-lièvre (Lagochilus), commun dans les régions montagneuses d'Asie centrale, les bractées situées à la base des faux verticilles sont modifiées en de puissantes épines qui protègent la plante de la consommation des herbivores. Chez certaines autres Lamiacées, les bractées ou les feuilles supérieures, et parfois les dents des feuilles, sont transformées en épines.
Le calice et la corolle des Lamiacées sont généralement formés de 5 folioles fusionnées avec leur partie principale en un tube. Seuls quelques genres, comme le genre Preslia de la Méditerranée occidentale, ont un périanthe à quatre chaînons. Le calice des Lamiaceae peut avoir une grande variété de formes : tubulaire, en forme de cloche, en forme d'entonnoir, sphérique, et dans le pharynx, il peut être soit à deux lèvres sans dents, soit à 5(4) dents avec des dents du de longueurs identiques ou différentes (dans ce dernier cas, le calice est également plus ou moins bilobé). Contrairement à la corolle, dont les modifications sont associées à l'adaptation à la pollinisation, les modifications du calice sont généralement associées à l'adaptation à la répartition des fruits. Souvent (par exemple, dans l'agripaume), les dents du calice ont l'apparence d'épines courbées sur le côté. Parfois, le calice entier ou ses dents grandissent considérablement, augmentant la dérive du calice à mesure que les graines sont dispersées par le vent, ou le calice devient de couleur vive, jouant un rôle en attirant les insectes ou les oiseaux pollinisateurs, par exemple le calice rouge vif de Salvia splendor . Le calice du grand genre (environ 300 espèces), presque cosmopolite, Scutellaria, est très original. Ici, il a deux lèvres avec des lèvres extérieures entières et, une fois le fruit mûri, il se brise en 2 parties qui ressemblent à des valves : la partie inférieure restante et la partie supérieure tombant. La partie supérieure du calice de nombreuses espèces de ce genre porte également un pli transversal en forme d'écaille - le scutellum. Scutellaria présente un certain nombre d'autres caractéristiques qui distinguent ce genre des autres genres de Lamiaceae (y compris l'absence de glandes huileuses essentielles), et ce n'est pas un hasard si certains auteurs ont même proposé de le séparer en une famille spéciale des Scutellariaceae.
Comme mentionné ci-dessus, la corolle des Lamiacées est généralement divisée en deux lèvres, dont la supérieure est formée de 2 et celle du bas de 3 pétales. La lèvre supérieure peut être plate ou convexe, parfois elle est entière, de sorte qu'aucune trace de la présence de 2 pétales n'est retrouvée. La lèvre inférieure est presque toujours plus grande (un site d'atterrissage pour les pollinisateurs), trilobée avec un lobe moyen plus grand et souvent à son tour bilobé.
Le fruit des Lamiacées est constitué de 4 lobes à une seule graine et pour la plupart en forme de noix, ayant des formes très différentes. Lors de la fructification, la corolle tombe généralement (mais reste dans les fleurs cléistogames et dans certains genres de la sous-famille tenace), et le calice reste toujours et grandit souvent (en particulier chez les espèces du genre Molucella et Hymenocrater). graines, moins souvent conservées, ce qui est une caractéristique primitive. L'endosperme le plus développé se trouve dans les espèces de la sous-famille australienne des Prostantheraceae et dans le genre Tetrachondra. La membrane externe des lobes du fruit porte souvent des tubercules, des papilles ou des poils, qui sont associés aux mode de leur distribution.
Selon les dernières données, la famille des Lamiacées compte environ 200 genres et 3 500 espèces, répartis presque partout dans le monde. Les lamiacées sont particulièrement nombreuses dans les pays à flore méditerranéenne ancienne - des îles Canaries à l'Himalaya occidental, où elles jouent souvent un rôle de premier plan dans les groupes végétaux. Les Lamiacées sont presque totalement absentes de l'Arctique et de l'Antarctique. Il y a très peu de Lamiacées dans la zone de la taïga. Les régions montagneuses des tropiques, notamment d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud, sont assez riches en Lamiacées. En Australie, les genres de la sous-famille des Prostanteraceae sont majoritairement endémiques à ce continent (6 genres et environ 100 espèces). La Nouvelle-Zélande est encore plus pauvre en Lamiacées, où il n'existe qu'une seule espèce de scutellaire et de menthe (toutes deux endémiques) et une des deux espèces du genre très particulier Tetrachondra (la deuxième espèce se trouve en Patagonie). Le genre Tetrachondra est parfois classé comme une famille distincte. Les îles hawaïennes sont relativement riches en Lamiaceae, avec 2 genres endémiques de la sous-famille des Prasiaceae à prédominance tropicale. Parmi les Lamiacées, les xérophytes des hautes et basses terres prédominent dans les habitats secs et ouverts, mais parmi elles, on trouve également de nombreuses plantes mésophiles des forêts et des prairies. Seules quelques espèces sont représentées dans les forêts tropicales humides. Il n'existe pas de véritables plantes aquatiques parmi les Lamiacées, mais il existe plusieurs genres dont de nombreuses espèces vivent le long des berges des réservoirs et dans les marécages. Tels sont par exemple les genres très répandus menthe, zyuznik et scutellaire. Les relations des Lamiacées avec leurs insectes pollinisateurs (et en Amérique tropicale et subtropicale également avec les colibris) sont très complexes et sont le résultat d'une longue évolution conjuguée. Les espèces de genres aux fleurs les plus simplement disposées, ayant une corolle presque régulière avec un tube court et 4 étamines de longueur presque égale (par exemple, la menthe) sont généralement pollinisées par de petits hyménoptères et des mouches, car le nectar qu'elles contiennent est facilement accessible. Chez la plupart des autres Lamiacées à corolle bilabiale bien définie, les étamines et le style sont adjacents à la lèvre supérieure, et le nectar est placé dans la partie inférieure d'un tube assez long. Les pollinisateurs de ces fleurs sont principalement des hyménoptères et des papillons, moins souvent de grosses mouches de la famille des syrphes. Les visiteurs d'une fleur touchent d'abord le stigmate, puis les anthères, et emportent une partie du pollen qui s'y trouve. Chez le fermoir et certains autres genres, l'envoi du pollen vers le dos de l'insecte est facilité par la présence de poils orientés vers le bas sur les anthères, que l'insecte touche. Des dispositifs remarquables, comme un levier ou une barrière, qui ouvre l'accès à l'hectare seulement après que le pollen soit tombé sur le dos de l'insecte, sont présents chez les espèces de Zopnik et de Chernogolovka (Prunella), mais ils atteignent la plus grande perfection chez les espèces de sauge. , dans lequel les anthères des deux étamines existantes sont transformées en une sorte de dispositifs à levier mobiles. L'insecte pollinisateur, afin d'obtenir du nectar, enfonce sa tête dans le tube de la corolle, pousse le rudiment expansé en forme de cuillère du nid d'anthère inférieur vers l'intérieur et vers le haut, et le nid d'anthère fertile, situé à l'autre extrémité du conjonctif allongé, frappe le dos de l'insecte et y déverse du pollen. Les Lamiacées américaines des genres Salvia, Scutellaria, Monarda et autres ont souvent de grandes fleurs rouges pollinisées par de grands papillons de nuit et des colibris. Ces derniers, comme les papillons de la famille des sphinx, planent près des fleurs, sucent le nectar avec leur bec et touchent de la tête les stigmates et les étamines situées sous la lèvre supérieure ou dépassant de la corolle.
Chez certaines Lamiaceae (en particulier les genres de la sous-famille des Basilaceae), les étamines et le style sont placés sur la lèvre inférieure, de sorte que l'insecte visitant la fleur (généralement des papillons) emporte le pollen sur la face inférieure de l'abdomen. Chez d'autres genres de Lamiacées, le même effet (position inférieure des étamines et du style) est obtenu grâce à la torsion du tube de la corolle (la lèvre supérieure devient comme une lèvre inférieure), à la torsion du pédoncule et à une inflorescence fortement tombante (par exemple , chez la sauge tombante - S. nutans, les inflorescences fleuries sont inversées de haut en bas). La possibilité d'autopollinisation des fleurs de Lamiacées est souvent éliminée en raison de la maturation plus précoce des étamines par rapport au stigmate (protandrie), mais dans de nombreux autres cas, l'autopollinisation est tout à fait possible. Il convient de noter que chez de nombreuses Lamiacées, non seulement la corolle, mais aussi d'autres parties de la fleur et de l'inflorescence participent à l'attraction des insectes et des oiseaux. Ainsi, la sauge brillante a des calices rouge vif et la sauge de chêne (S. nemorosa) a des bractées bleu-violet.
De nombreuses Lamiacées se propagent par le vent (anémochorie). Les unités de distribution - les diaspores - dans ce cas sont généralement des parties à graine unique d'un fruit fractionné, dont la dérive peut augmenter en raison de leur pilosité ou de la formation d'excroissances en forme d'aile ou de touffe. Ainsi, dans le genre Tinnea, répandu en Afrique tropicale, les fruits présentent des boucliers en forme de touffe. Chez les Lamiacées anémochores, les tiges restent souvent sèches longtemps, dispersant progressivement les fruits (même en hiver). Dans d'autres cas, au contraire, les tiges ramifiées évasées aux inflorescences fruitières se cassent facilement à leur base et roulent sur la steppe avec le vent, dispersant progressivement les fruits. Ces tumbleweeds sont certains types de sauge, de zopnik, d'herbe à chat, etc. Plus les fruits ne tombent pas longtemps des tasses, plus la distance sur laquelle ils seront transportés est grande. Ainsi, de nombreuses Lamiacées possèdent des dispositifs permettant de maintenir les fruits dans le calice : un anneau de poils dans son pharynx ou des dents recourbées vers l'intérieur. Chez de nombreuses Lamiacées anémochores, les lobes du fruit tombent avec le calice. Le vent dans ces cas est obtenu soit en raison de dents du calice relativement longues et souvent ciliées (par exemple, dans le thym - Thymus), soit en raison de la forte croissance du tube du calice et de ses dents. Ainsi, chez la Molucella (Molucella), le tube du calice pendant les fruits est considérablement élargi, membraneux et largement en forme de cloche, tandis que chez le bec-de-lièvre, au contraire, les dents du calice augmentent considérablement en largeur. Chez certaines espèces d'Otostegia, le rôle de la mouche est joué par la lèvre supérieure membraneuse très élargie du calice, et chez le saccocalyx algérien (Saccocalyx satureioides), le calice du fruit est gonflé en forme de bulle avec un pharynx fermé, qui permet aux fruits qu'ils contiennent d'être transportés par le vent sur de longues distances.
Parmi les Lamiacées, il existe de nombreuses espèces qui se propagent à l'aide d'animaux, et les adaptations à la zoochorie ne sont pas moins diverses. De nombreuses Lamiacées ont des membranes mucilagineuses des lobes des fruits lorsqu'elles sont mouillées et peuvent se propager à la fois par endozoochore (avec l'aide d'animaux frugivores, principalement des oiseaux) et par épizoochore (sur la laine et les plumes, ainsi que sur les pattes des animaux et des humains). Une plus grande efficacité de l'endozoochorie est obtenue grâce à la formation de lobes de fruit en forme de drupe avec une coquille charnue juteuse (dans le genre méditerranéen Prasium). Dans le genre Hoslundia d'Amérique tropicale, le calice devient charnu (en forme de baie) lors de la fructification, dont la gorge est fermée par des dents. Les espèces à lobes de fruits adhésifs ou poilus se propagent de manière épizoochore. Dans de nombreux cas, la propagation épizoochorique est également facilitée par la chute des calices avec les fruits, les poils durs et les dents dures dépassant sur les côtés, qui constituent un excellent dispositif d'ancrage dans la fourrure animale.
Les fruits de certaines Lamiacées (en particulier les espèces de poissons tenaces et de demoiselles) ont des appendices disposés de diverses manières qui servent de nourriture aux fourmis. Ils se caractérisent par le mode de distribution dit myrmécochore. L'espèce brésilienne Glasio hiptis (N. glasiovii) appartient généralement aux plantes « aimant les fourmis » (myrmecophiles) : dans les entre-nœuds gonflés de ses tiges se trouvent constamment des colonies de fourmis spéciales. Les espèces de Lamiacées qui vivent près des rives des plans d'eau et dans les marécages (par exemple, les espèces de menthe et de sauterelle) ont des lobes de fruits flottants, adaptés à la dispersion par les courants d'eau, mais en partie aussi par les animaux aquatiques. Lamiacées extratropicales. Parmi les représentants de cette sous-famille, il convient de mentionner en premier lieu le genre Pogostemon, qui compte environ 40 espèces, réparties en Chine et en Asie tropicale. Les représentants utiles de la sous-famille comprennent également 5 espèces du genre Perilla, communes en Asie du Sud, de l'Est et du Sud-Est. Le genre menthe (Mentha, environ 25 espèces dans la zone tempérée de l'hémisphère nord, en Afrique du Sud et en Australie) est encore plus important. Les fleurs des espèces de menthe sont presque actinomorphes, à quatre chaînons, avec 4 étamines presque identiques. L'hysope (Hyssopus officinalis) est également cultivée comme huile essentielle, plante médicinale et ornementale. Les espèces du genre Origanum (Origanum) revêtent également une certaine importance. Environ 15 à 20 espèces de ce genre sont connues, réparties en Europe, dans les régions méditerranéennes et tempérées d'Asie. L’un des représentants les plus célèbres de la famille est le genre thym (Thymus), qui compte de 35 à 400 espèces, selon le point de vue du taxonomiste sur la taille de l’espèce. Les feuilles de thym contiennent des huiles essentielles, principalement du thymol, utilisées en médecine. Les feuilles sont utilisées comme épice dans les industries des conserves et des boissons alcoolisées. Le thym méditerranéen (T. vulgaris) est largement cultivé dans les pays tempérés et tropicaux. Des espèces du genre Melissa (Melissa, 5 espèces en Eurasie) sont également utilisées. La mélisse officinalis, ou mélisse (M. officinalis), est cultivée comme plante à huile essentielle, mellifère et épicée. Proche de la mélisse se trouve le genre sarriette (Satureja), qui compte jusqu'à 200 espèces, commune dans les régions tempérées et subtropicales. La sarriette (S. hortensis) est cultivée comme plante à huile essentielle. Il est utilisé comme épice, en médecine et en parfumerie, ainsi que pour aromatiser les liqueurs et les cognacs. Enfin, la sarriette des montagnes (S. montana) est cultivée comme plante ornementale. Stachys est l'un des grands genres de la sous-famille, comptant environ 300 espèces, réparties dans les régions tempérées, subtropicales et tropicales, mais absentes toutefois en Australie et en Nouvelle-Zélande. Certaines espèces de chistets jouent un rôle notable dans la composition du couvert végétal. La sauge est le plus grand genre de la famille des Lamiacées. Le nombre d’espèces de sauge atteint 700 et elles sont largement réparties dans les régions tempérées, subtropicales et tropicales. Certaines espèces de sauge jouent un rôle prédominant dans le couvert végétal. La Salvia officinalis (S. officinalis) est largement cultivée et bien connue de tous. La sauge brésilienne à coupe et corolle rouge vif est devenue une plante ornementale très appréciée dans les jardins et les parcs. L'espèce mexicaine de sauge narcotique (S. divinorum) contient des substances ayant un effet narcotique, connues des anciens Mexicains. Au Pérou, la fleur sacrée était considérée comme la sauge à fleurs opposées (S. oppositiflo-ha) - un arbuste à fleurs rouges de 2,5 à 3 cm de long. Parmi les autres représentants médicinaux de cette sous-famille, on mentionne également l'agripaume (Leonurus hearta) - un remède cardiaque bien connu, l'encensoir (Melittis melissophyllum), espèce de ziziphora (Ziziphora), bec-de-lièvre. La dernière place du système Melchior est occupée par la sous-famille des Scutellarioi-deae, la plus spécialisée en structure. Le système des Lamiaceae est encore loin d'être parfait et est en cours de développement. Tout d’abord, la frontière qui sépare les Lamiacées de la famille des Verbénacées, étroitement apparentée mais plus primitive, n’est pas encore tout à fait claire. Ainsi, certains auteurs proposent de classer deux sous-familles de Lamiacées parmi les verveines, similaires dans la structure du gynécée à de nombreux genres de verveines - les prostantéracées et tenaces ; d'autres, au contraire, proposent de transférer une partie importante de la famille des verveines aux Lamiacées. Selon l'un des derniers systèmes de la famille des Lamiacées, développé par le botaniste allemand H. Melchior (1964), elle est divisée en 9 sous-familles. La première place parmi elles est occupée par la sous-famille australienne des Prostantheroideae, qui se distingue par la structure relativement primitive du gynécée et des graines avec endosperme, mais ayant une structure de périanthe assez hautement spécialisée. Vient ensuite la sous-famille tenace (Ajugoideae), qui possède un gynécée comme les prosantheraceae, mais des graines sans endosperme. Ceux-ci incluent les genres tenaces, chênaie (Teucrium), améthystea (Amethystea), etc. Une sous-famille monotypique spéciale du romarin (Rosmarinoideae) comprend le genre romarin (Rosmarinus) avec une corolle prononcée à deux lèvres, 2 étamines et des graines sans endosperme.
La sous-famille suivante est Basilacées (Ocimoideae), comme toutes les sous-familles ultérieures, diffère des sous-familles précédentes par un gynécée plus spécialisé avec une colonne gynobasique clairement définie. Il y a 4 étamines, rarement 2. Les représentants de cette sous-famille sont répartis presque exclusivement dans les pays tropicaux et subtropicaux. Le plus grand genre, Hyptis, contient plus de 350 espèces, réparties principalement en Amérique du Sud et centrale. Ce genre comprend les arbres les plus hauts parmi les Lamiacées, poussant dans les forêts du Brésil. Le genre Hiptis comprend deux espèces économiquement importantes : Hiptis spicigera, cultivée pour obtenir de ses graines une huile semblable à celle du sésame, et Hiptis suaveolens, ou « sangura », qui produit un thé médicinal très aromatique. Le genre basilic (Ocimum) compte jusqu'à 150 espèces, réparties dans les pays tropicaux et subtropicaux, notamment en Afrique. Ce genre comprend le basilic noble (O. basilicum), originaire d'Asie tropicale, cultivé dans de nombreux pays, y compris dans les régions méridionales. ex-URSS comme une plante épicée. En Chine, la culture de cette plante est connue depuis 500 avant JC. e. Un autre représentant bien connu de ce genre est le basilic eugénole (O. gratissimum) - un arbuste originaire d'Asie tropicale, cultivé notamment en Géorgie et dans les régions méridionales du territoire de Krasnodar comme plante à huile essentielle. Le basilic sacré (O. sanctum), un arbuste paléotropical cultivé en Inde et dans d'autres pays comme plante cultivée, est également célèbre. Le genre Plectranthus comprend environ 250 espèces réparties dans les pays tropicaux et subtropicaux de l'Ancien Monde. Un certain nombre d'espèces de ce genre atteignent le nord du Japon et les régions méridionales de l'Extrême-Orient. Enfin, il convient de mentionner le genre paléotropical Coleus. Certaines espèces, dont Coleus (C. edulis), ont des racines tubéreuses féculentes et sont cultivées comme plantes alimentaires sous les tropiques de l’Ancien Monde. De nombreuses espèces sont ornementales et certaines sont cultivées à l’intérieur et dans les jardins. L'espèce indo-malaise Coleus amboinicus (C. amboinicus) est utilisée comme assaisonnement alimentaire, et les racines du Coleus vettiverioides indien (C. vettiverioides) sont utilisées pour diverses décorations. La sous-famille des Catopheriaceae (Catopherioideae) ne comprend qu'un seul genre de catopheria (Catopheria, 3 espèces), réparti du Mexique à la Colombie. Les types de catophérie sont des plantes d'apparence très originale, caractérisées par un embryon avec une racine succulente adjacente aux cotylédons. La sous-famille de la lavande (Lavanduloideae) ne contient également qu'un seul genre de lavande (Lavandula). Le genre lavande, qui compte environ 28 espèces, est réparti principalement en Méditerranée et en Macaronésie, mais son aire de répartition s'étend jusqu'en Somalie en Afrique et en Inde. Cela inclut les sous-arbrisseaux et les arbustes. Certaines espèces sont utilisées depuis l’Antiquité pour obtenir de précieuses huiles essentielles. La lavande angustifolia (L. angustifolia) est un arbuste atteignant 1 m, et parfois jusqu'à 2 m de hauteur, largement cultivé pour obtenir de précieuses huiles essentielles et est également très apprécié comme plante ornementale. Les huiles essentielles sont également obtenues à partir de lavande à feuilles larges (L. latifolia) et de certaines autres espèces. Les fleurs et les feuilles séchées de lavande conservent longtemps un parfum épicé et sont utilisées pour éloigner les mites. La sous-famille suivante, Prasioideae, comprend 6 genres, répartis principalement en Asie tropicale. Un seul genre monotypique Prasium se trouve dans la région méditerranéenne, du Portugal à la Yougoslavie. Prasium, comme d'autres représentants de la sous-famille, se caractérise par des lobes de fruit en forme de drupe.
À une vaste sous-famille Lamiacées (Lamioideae, Melchior l'appelle Stachyoideae) appartient à la grande majorité des fleurs. Cette sous-famille ne comprend que deux genres : le grand genre Scutellaria, avec environ 300 espèces, très largement réparties dans le monde (à l'exception de l'Afrique du Sud), et le genre monotypique Salazaria, distribué aux États-Unis et au Mexique. Plus naturel par rapport au système Melchior est le système des Lamiaceae, proposé en 1967 par R. Wunderlich. Elle repose principalement sur la structure des fruits et des grains de pollen, et a été récemment confirmée par des données de chimiotaxonomie. Wunderlich n'accepte que 6 sous-familles : Prostanteraceae, Tenacious, Scutellariaceae, Chestaceae, Savory (Saturejoideae) et Catopheriaceae. Elle combine la sous-famille des Prasiacées Melchior avec les Chistetsacées, et les sous-familles du romarin et de la lavande avec la sous-famille salée qu'elle distingue des Chistacées. Les basilacées de Melchior rejoignent également la famille des sarriettes Wunderlich, mais occupent une place à part dans cette sous-famille. Bien que le système phylogénétique de Wunderlich présente plusieurs avantages, il subira sans aucun doute d’autres changements.
Ordre des Lamiales (N. N. Tsvelev)
Famille des verveines (Verbénacées)
Dans les pays extratropicaux, la famille des verveines est peu connue. Seulement verveine hybride(Verbena hybrida), largement cultivée comme plante ornementale, est familière à beaucoup. Sans compter plusieurs espèces sauvages et introduites de cette famille en provenance d'autres pays, seulement 2 espèces de verveine, vitex sacré(Vitex agnuscastus, fig. 213) et frima gracile(Phryma leptostachya), pousse à l'état sauvage dans notre pays. Cependant, les Verbénacées constituent une famille assez nombreuse, en nombre d'espèces à peine inférieure à la famille étroitement apparentée des Lamiacées, largement représentée dans notre pays et qui joue un rôle important dans la végétation des pays tropicaux.
Contrairement aux Lamiacées, parmi les verveines, les arbustes et les arbres prédominent nettement sur les herbes. Certains arbres, par exemple grand tectonique(Tectona grandis, fig. 212), atteignent une hauteur de plus de 50 m. Arbustes et arbres bas d'un genre répandu sous les tropiques avicenne(Avicennia, voir Fig. 213) sont importants partie intégrante mangroves sur les côtes des mers et des océans. Comme certaines autres espèces de ces groupes végétaux remarquables à bien des égards, elles ont des racines respiratoires spéciales - des pneumatophores, poussant verticalement vers le haut, dépassant du limon à marée basse et fournissant de l'oxygène aux parties souterraines de la plante.
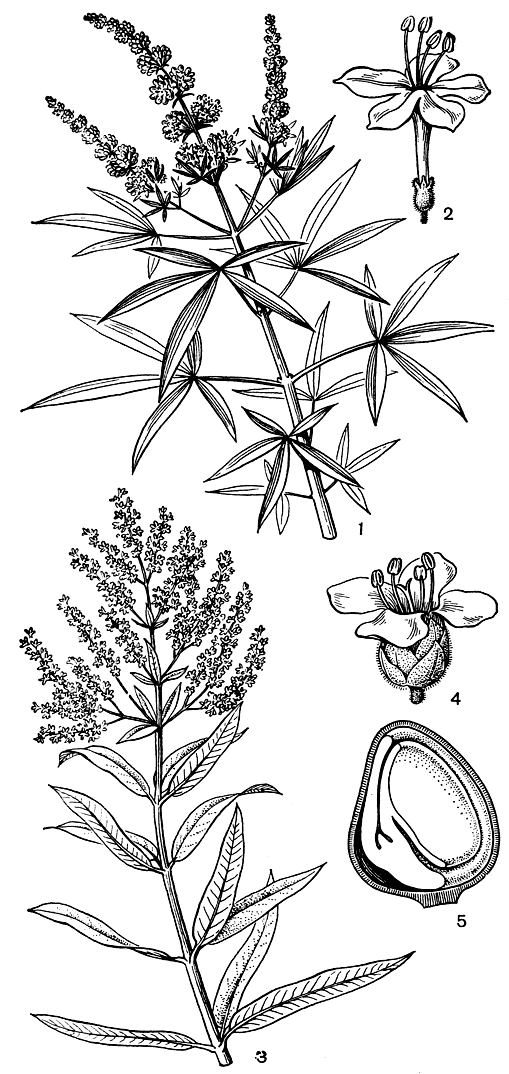
Parmi les autres verveines arbustives, il existe à la fois des formes « éricoïdes » (ressemblant à de la bruyère) avec de très petites feuilles coriaces, et des formes originales ressemblant à des brindilles sans ou presque sans feuilles, parfois avec des tiges à larges ailes. L'arbuste extratropical sud-américain est particulièrement intéressant. conifère néosparton(Neosparton ephedroides), ayant des tiges articulées presque sans feuilles avec des branches opposées ou verticillées et extérieurement extrêmement similaires à l'éphédra de la plante gymnosperme.
De nombreuses verveines sont des vignes arbustives, généralement grimpantes, parfois à l'aide de supports de racines adventives, moins souvent grimpantes ( Par exemple, Clérodendrum de Thomson- Clerodendrum thomsoniae). Lantana a du lilas(Lantana lilacina) 2 ou les 4 côtes d'une tige tétraédrique se développent considérablement, ce qui fait que les tiges deviennent en forme de ruban ou à quatre ailes. Plus tard, la partie médiane de la tige est détruite et 2 ou 4 parties de la tige initialement unique sont séparées les unes des autres, comme si elles devenaient des tiges indépendantes.
Toutes les verveines herbacées appartiennent aux plantes vivaces. Il n'existe pas de véritables annuelles, bien que certaines espèces cultivées ou introduites origine tropicale dans les climats modérément chauds, ils se comportent comme des annuelles. Les herbes à tiges tétraédriques dressées prédominent, mais d'autres formes de vie sont également présentes. Ainsi, chez une adventice répandue sous les tropiques et introduite dans le sud de l'URSS comme plante introduite Lippia repens(Lippia repens) tiges presque filiformes s'étalant sur le sol et prenant racine au niveau des nœuds.
Les feuilles de la verveine sont généralement opposées, moins souvent alternes ou verticillées (par exemple, dans les cultures cultivées). Aloysia trifolia- Aloysia triphylla), entières ou diversement disséquées, toujours sans stipules. Pour l'un des genres les plus nombreux de la famille - vitex(Vitex) - les feuilles composées palmées avec (1) 3 à 7 folioles sont caractéristiques. Parfois, les feuilles sont fortement modifiées, au point même d'être complètement réduites chez certains arbustes ramifiés et arbustes nains. U feuillage d'asperge verveine(Verbena asparagifolia), les feuilles sont entièrement modifiées en une épine tripartite, et chez les verveines en forme de coussin de la section Pungentes (Pungentes), les feuilles coriaces, étroitement serrées sur des tiges raccourcies, sont dessinées au sommet en une épine assez longue. U clérodendrum épineux(Clerodendrum aculeatum) les pétioles des feuilles deviennent des épines après la chute des limbes.
Les feuilles, ainsi que d'autres parties de la plante, ont généralement une pubescence de poils simples, glandulaires, écailleux ou étoilés, mais il existe aussi des espèces complètement dépourvues. De nombreux clérodendrums ont des nectaires extrafloraux sur la face inférieure des feuilles, le long de la nervure médiane. Feuilles du genre américain pétrée(Petrea) sont intéressants en raison de la présence sur eux d’organes sensibles à la lumière appelés ocelles. Ce sont des poils spéciaux dont la base convexe est située dans des fosses profondes et dont seule la pointe en forme de cône s'élève au-dessus de l'épiderme. Les espèces d'Avicennia qui vivent dans les mangroves ont des stomates spéciaux sur la face inférieure de leurs feuilles qui servent à éliminer l'excès de sel. Par temps sec, le sel qu'elles libèrent recouvre la face inférieure des feuilles d'une couche continue, leur donnant une teinte grisâtre. La plupart des espèces de verveine ont des stomates diacytiques ; ils sont rarement paracytiques ou anomocytaires.
Généralement, les fleurs à cinq chaînons des Verbenaceae sont réunies en inflorescences de type apical ou à floraison latérale, qui sont construites de diverses manières et comportent pour la plupart des bractées. Dans ce dernier cas, ils peuvent être racémeux, en forme d'épi (par exemple chez de nombreuses espèces de verveine) ou capités (par exemple chez Lippia repens). Dans les inflorescences de type arachnoïde, des semi-parapluies (dichasia) peuvent être localisés à l'aisselle des feuilles ou à l'aisselle des bractées, formant souvent des inflorescences paniculées, corymbes ou ombellées. Les bractées des inflorescences de verveine sont souvent colorées et participent à attirer les insectes pollinisateurs. Ainsi, chez certaines espèces de lantana (Lantana), des bractées aux couleurs vives forment une enveloppe qui enveloppe l'inflorescence en forme de tête.
Les fleurs de verveine sont plus ou moins zygomorphes, le calice conservant beaucoup plus souvent une structure actinomorphe que la corolle. Les fleurs complètement actinomorphes avec un périanthe à cinq ou six chaînons ne sont connues que dans le genre Malésien. gyonsie(Geunsia), qui possède également 5 à 6 étamines dépassant loin de la corolle. Le calice est toujours fusionné et a une forme tubulaire en forme de cloche ou d'entonnoir. Le nombre de ses dents ou lobes varie de 2 à 8, mais est généralement égal à 5. Souvent, les dents sont peu développées et dans le genre paléotropical holmsheldia(Holmskioldia) le bord du calice en forme d'entonnoir très large est complètement dépourvu de dents. Dans la famille indo-malésienne hyménopyramis(Hymenopyramis) le calice, qui se développe fortement lors de la fructification, est coloré couleur blanche et possède 4 larges ailes longitudinales. Le clérodendrum de Thomson africain (Glerodendrum thomsoniae), largement cultivé en serre, possède également des calices plutôt grands et de couleur blanche avec des corolles rouge vif. La structure des coupes du clérodendrum indonésien Minahassae (C. minahassae) est très originale. Non seulement avant la floraison, mais aussi pendant celle-ci, ils sont gonflés, bien fermés et remplis d'eau sécrétée par les stomates d'eau - les hydathodes. De telles coupes protègent bien les parties internes de la fleur et le nectar des attaques d'insectes non pollinisateurs. Quelques autres verveines pour protéger les fleurs et le nectar qu'elles contiennent invités non invités recourir à l'aide de fourmis. En javanais bractées de gmelina(Gmelina bracteata) les calices ont des nectaires extrafloraux, très activement visités par les fourmis. Une véritable plante qui aime les fourmis est Clerodendrum myrmécophile(Glerodendrum myrmecophilum), dont les entre-nœuds creux des tiges servent de foyer permanent aux fourmis. Il est intéressant de noter que ces habitations ont des entrées spéciales sur de petites excroissances dans la partie supérieure des entre-nœuds. Sur chacune de ces excroissances se trouve une section de tissu très fin qui est facilement rongée par les fourmis lorsqu'elles habitent la maison pour la première fois.
La structure de la corolle pétale d'une fleur de verveine varie encore plus que la structure du calice : d'actinomorphe (chez Gensia) à bilabiée et très similaire à la corolle des Lamiacées. La taille de la corolle varie également beaucoup, atteignant une longueur de 15 cm chez certaines espèces de clérodendrum, pollinisées par des papillons à trompe longue. Les deux lobes inférieurs de la corolle ont tendance à fusionner, et donc de nombreuses verveines ont une corolle à quatre chaînons. Certains types de clérodendrum ont une lèvre inférieure de la corolle envahie par la saccule, dans d'autres cas (dans le Brésil monochilus- Monochilus) la corolle dans la partie inférieure est au contraire profondément fendue. À l'intérieur du tube de la corolle se trouvent souvent des dispositifs permettant de conserver le nectar - nektarostegia. Oui, oui beaucoup(Premna) surface intérieure les tubes sont couverts de poils, et chloanthes(Chloanthes) dans la partie inférieure du tube se trouve un anneau de poils ramifiés densément localisés. La couleur des corolles peut être très différente, mais rouge, rose et couleurs violettes. Cultivé en serre Lantana Camara(Lantana camara) les corolles changent de couleur 3 fois : dans les fleurs nouvellement épanouies elles sont orange, puis elles deviennent jaunes et vers la fin de la floraison elles deviennent rouge foncé.
Le nombre d'étamines dans les fleurs de verveine peut être de 5 (par exemple, chez tectona), mais il n'y a généralement que 4 étamines (parfois un cinquième staminode) attachées au tube de la corolle. Chez la Mallophora australienne, les filaments des étamines sont très courts (les anthères sont presque sessiles) et sont attachés au tube de la corolle entre les lobes de la corolle. Chez le tektona, au contraire, des filaments d'étamines plus longs sont attachés presque à la base du tube de la corolle. L'une des paires d'étamines est souvent moins développée et est souvent représentée par des staminodes.
Les anthères de la verveine sont toujours introsulaires avec des nids parallèles ou divergents. Dans la famille américaine stachytarpheta(Stachytarpheta) les nids d'anthères sont tellement divergents qu'ils sont situés sur une seule ligne et les anthères donnent l'impression d'être monolobées.
Le gynécée de la verveine est généralement formé de 2, moins souvent de 4 (en Durant- Duranta) ou 5 (en Geunsia) carpelles. Chez Lantana, Lippia et quelques autres genres, la partie postérieure des deux carpelles est réduite. Il se forme un gynécée pseudomonomère, qui est cependant divisé en deux par un faux septum avec un ovule dans chaque partie et devient secondairement biculaire. Dans de nombreux genres avec un gynécée bicarpelle, chacun des deux nids primaires est également divisé par un faux septum en 2 nids monograines et le gynécée devient secondaire à quatre loculaires. Le style s'étend généralement à partir du sommet de l'ovaire, moins souvent il est plus ou moins enfoui entre ses lobes, comme dans la famille étroitement apparentée des Lamiacées.
La pollinisation croisée des fleurs de verveine bisexuée est presque toujours facilitée par la protandrie, et dans certains cas par l'hétérostylie. Uniquement dans un genre commun en Amérique tropicale aegifila(Aegiphila) il existe une dioïcie incomplète : certains individus portent des fleurs mâles avec des étamines dépassant loin du tube de la corolle et un gynécée sous-développé ; d'autres sont des fleurs femelles avec des étamines rudimentaires et un gynécée bien développé.
Les fruits de la famille de la verveine revêtent une grande importance lors de la division de cette famille en sous-familles et tribus. Le type de fruit habituel est une drupe contenant 2 à 4 graines et un endocarpe charnu ou juteux. Dans le genre verveine, riche en espèces, et dans certains autres genres, le fruit sec se divise en 4 lobes en forme de noix. Un autre nombre de genres ont une fruitière, s'ouvrant par 2 ou 4 valves. Le calice reste généralement avec le fruit et se développe souvent considérablement. Les graines ont un embryon direct et sont généralement dépourvues d'endosperme (il est présent dans Avicennia et quelques autres genres). Avicennia possède une autre caractéristique remarquable des graines associée au fait de vivre dans les conditions spécifiques des mangroves. La germination des graines commence déjà sur la plante mère et les fruits à une seule graine qui tombent (en raison de la réduction des 3 autres ovules) ne portent pas l'embryon habituel caractéristique des autres verveines, mais une plantule pleinement développée.
Selon les dernières données, les verveines comprennent environ 100 genres et 3 000 espèces, réparties presque exclusivement dans les pays tropicaux et subtropicaux des deux hémisphères. Seuls quelques genres (verveine, vitex, etc.) pénètrent dans les régions méridionales des régions modérément chaudes, où ils ne sont également représentés que par quelques espèces. Les verveines les plus riches sont l'Asie du Sud-Est avec l'archipel malais (on y trouve de nombreux genres endémiques), l'Amérique centrale avec les îles Mer des Caraïbes et l'Amérique du Sud. En Afrique tropicale, la variété des verveines est moins grande, mais les genres Clerodendrum et Vitex sont ici représentés par de nombreuses espèces. De plus, 3 petits genres sont endémiques à Madagascar, 1 genre est endémique à l'île de Socotra, et le genre stilba(Stilbe) avec 4 genres apparentés - pour l'Afrique du Sud.
Parmi les verveines, on trouve de nombreuses plantes des forêts tropicales, dont des espèces forestières (espèces Tektona, Vitex, etc.). Les espèces d’Avicennia, comme déjà mentionné, font partie des plantes les plus caractéristiques des mangroves de presque tous les pays tropicaux. De plus, c’est le seul genre de plantes de mangrove qui s’étend au-delà des tropiques en Nouvelle-Zélande. arbuste bas Le Vitex sacré, ou « arbre d'Abraham » (voir Fig. 213), joue un rôle important dans la végétation du littoral mer Méditerranée. En Amérique du Sud, de nombreuses verveines sont des xérophytes des hautes terres, possédant souvent des formes de vie très originales (coussins épineux, arbustes ressemblant à des brindilles, etc.).
Les relations entre les fleurs de verveine et leurs pollinisateurs sont variées mais mal comprises. Les espèces de genres avec un tube de corolle court sont généralement pollinisées par de petits hyménoptères et des mouches, tandis que celles avec un tube plus long sont pollinisées par de grands hyménoptères et des papillons. Les espèces à plus grandes fleurs sont pollinisées par des papillons et des oiseaux à longue trompe (en Amérique - colibris, et en Asie, en Afrique et en Australie - souimangas et méliphages). Les fleurs pollinisées par les oiseaux sont inodores et ont généralement une corolle rouge qui attire particulièrement les oiseaux. Les espèces ornithophiles comprennent l'arbuste himalayen cultivé en serre Holmsheldia rouge sang(Holmskioldia sanguinea). Ses fleurs ont non seulement une corolle rouge, mais aussi une coupe très large peinte en rouge foncé. 4 étamines et un stigmate dépassent du tube de la corolle et touchent la tête d'un oiseau planant près de la fleur. Récemment, il a été constaté que les fleurs de lantana camara qui changent de couleur sont très pollinisées. petits insectes- les utriculaires ou les thrips. Les thrips ne se trouvent constamment qu'à l'intérieur des fleurs jaunes, qui ont des stigmates complètement développés. Ainsi, le changement de couleur des fleurs de cette espèce indique aux pollinisateurs à quelle heure visiter les fleurs.
Les espèces du genre verveine qui portent des drupes, y compris celles riches en espèces telles que Clerodendrum et Vitex, sont propagées par les oiseaux. Les calices aux couleurs vives de nombreuses espèces de Clerodendrum servent moyens supplémentaires pour les attirer. Les modalités de répartition des espèces à fruits secs n'ont pas encore été suffisamment étudiées. Parts de fruits de la mauvaise herbe rudérale européenne verveine officinale(Verbena officinalis) sont facilement transportées par le sol sur les pieds des humains et des grands animaux, bien que les tiges sèches très ramifiées de cette verveine puissent apparemment aussi être transportées par le vent, dispersant les fruits comme des tumbleweeds. Les fruits de l'Avicennia, qui vit sur les côtes des mers et des océans, sont distribués par voie d'eau lors des marées hautes et basses, et sur de plus longues distances lors des tempêtes.
L'importance des verveines dans la vie humaine est assez grande. Tout d’abord, de nombreux arbres tropicaux appartiennent à cette famille, donnant ainsi bois précieux. La particularité de ce bois est liée à la présence de résines spécifiques. Le plus célèbre d'entre eux est le tectona majora ou thèque (voir fig. 212). Dans certaines régions de l'Inde, de la Birmanie, de la Thaïlande et de l'île de Java, c'est une espèce forestière des forêts tropicales humides de feuillus. Actuellement, le tektona est cultivé non seulement en Asie du Sud et du Sud-Est, mais également en Afrique tropicale et en Amérique du Sud. Son bois se distingue par sa beauté, sa haute résistance et sa résistance à la pourriture et aux dommages causés par les insectes, et est facile à traiter. Il est utilisé principalement dans les industries de la construction navale et de la construction de voitures, ainsi que pour la fabrication de meubles, constituant un produit d'exportation important pour les pays d'Asie tropicale. Très bois dur donner appartenant à ce qu'on appelle " arbres de fer"espèce du genre américain cytarexyle(Citharexilum). Très hautes qualités Le bois de certaines espèces tropicales de vitex en possède également. L'espèce méditerranéenne de ce genre, Vitex sacré, est largement cultivée comme arbuste ornemental. Ses branches flexibles sont utilisées pour le tissage de divers produits. De plus, il contient des huiles essentielles et a déjà été utilisé dans Médecine populaire. Les fruits de cette espèce peuvent servir de substitut au poivre, et les drupes charnues de certaines espèces tropicales, comme l'Afrique. Vitex Mombasa(V. mombassae) sont assez largement utilisées comme aliment par la population locale.
Une huile essentielle précieuse à l'odeur agréable (citronnée) et donc utilisée en parfumerie et dans l'industrie alimentaire, donne Aloysia trifolia(Aloysia triphylla, voir fig. 212), également appelée « verveine citronnée ». Cet arbuste sud-américain aux feuilles verticillées est parfois cultivé dans les jardins et parcs du sud de l'URSS. De nombreuses autres verveines arbustives sont classées comme plantes ornementales. Parmi eux, il existe de nombreux types de clérodendrum (clérodendrum de Thomson, Élastique à clérodendrum- C. bungei, etc.), possédant souvent des calices de couleurs vives. C'est le plus grand genre de la famille (avec plus de 400 espèces). Les espèces de Lantana sont souvent trouvées en culture, en particulier Lantana Camara(Lantana camara) et belle carpe(Callicarpa), ayant des drupes bleu-violet ou violet-violet. Il existe plusieurs plantes herbacées ornementales dans le genre verveine(Verveine), comprenant plus de 300 espèces. Le plus célèbre d'entre eux verveine hybride(V. hybrida), issue de l'hybridation de plusieurs espèces sud-américaines et cultivée sur un vaste territoire de notre pays. D'autres espèces sont beaucoup moins fréquentes en culture. Certaines verveines ont valeur médicinale. Donc, verveine à feuilles d'ortie(V. urticifolia) est utilisé comme antipyrétique et tonique. Auparavant, la médecine européenne était également largement utilisée dans la médecine traditionnelle. verveine officinale(V. officinalis).
Famille des Lamiacées, ou Labiatae
Les représentants de cette famille sont facilement reconnaissables à la structure de la corolle des fleurs, qui possède un long tube et un pharynx à deux lèvres, rappelant la gueule béante d'un animal de conte de fées. Bien qu'une corolle d'aspect similaire soit présente dans plusieurs autres familles de plantes à fleurs (par exemple chez de nombreuses Norichacées), elle est particulièrement caractéristique des Lamiacées. Non moins particulier est le fruit des Lamiaceae, constitué de 4 lobes à une seule graine en forme de noix ou rarement en forme de drupe, tandis que chez les Norichineaceae, dont la structure de la corolle est similaire, le fruit est généralement une capsule à plusieurs graines. Les caractéristiques distinctives importantes des Lamiacées comprennent également des feuilles opposées (très rarement verticillées), généralement entières sans stipules et des tiges généralement tétraédriques. L'odeur aromatique caractéristique de la plupart des espèces de Lamiaceae est très importante, qui est déterminée par la présence sur tout ou partie de la plante de glandes qui sécrètent des huiles essentielles de composition complexe (elles comprennent des alcools aromatiques, des phénols, des terpènes, des aldéhydes et d'autres substances organiques). composés). C'est la présence de ces huiles qui détermine en grande partie l'utilisation pratique des Lamiacées comme plantes techniques, médicinales et aromatiques.
La plupart des Lamiacées sont des herbes et des arbustes. Cependant, parmi eux, notamment dans les régions tropicales et subtropicales, il existe également de nombreux arbustes, dont un exemple est celui commun dans la région floristique méditerranéenne. romarin officinalis(Rosmarinus officinalis, tableau 55) est un arbuste à feuilles persistantes avec de petites feuilles linéaires et des fleurs bleu-violet (à presque blanches) (Fig. 214). Lamiaceae - les arbres ne se trouvent que sous les tropiques, mais, contrairement à la famille étroitement apparentée des Verbenaceae, à prédominance ligneuse, ils ne comprennent que quelques espèces de deux genres américains : Hyptis et levcoceptrum(Leucosceptre). Le « champion » en hauteur parmi eux est l’espèce brésilienne hiptis membraneux(N. membranacea), atteignant une hauteur de 12 à 15 m, tandis que d'autres Lamiacées ligneuses n'atteignent généralement pas une hauteur de 5 M. Sous les tropiques, il existe également quelques lianes, auxquelles appartient seul le genre américain salazarie(Salazaria), certaines espèces Scutellaire(Scutellaria, planche 55) et le genre hawaïen sténogyne(Sténogyne).


Les tiges des Lamiacées herbacées sont généralement dressées et ne nécessitent pas de support, bien qu'il existe des espèces dont les tiges rampent sur le sol et s'enracinent dans les nœuds (par exemple, bourgeon à feuilles de lierre - Glechoma hederacea). Chez la plante grimpante rampante (Ajuga reptans), en plus des pousses reproductrices dressées, à l'aisselle des feuilles de la rosette, se forment des pousses végétatives arquées dirigées vers le sol et enracinées au sommet, semblables aux vrilles du fraisier. Une rosette bien développée de feuilles basales, qui persiste pendant la floraison de la plante, se retrouve chez de nombreuses Lamiacées herbacées (par exemple, chez certaines sauges - Salvia).
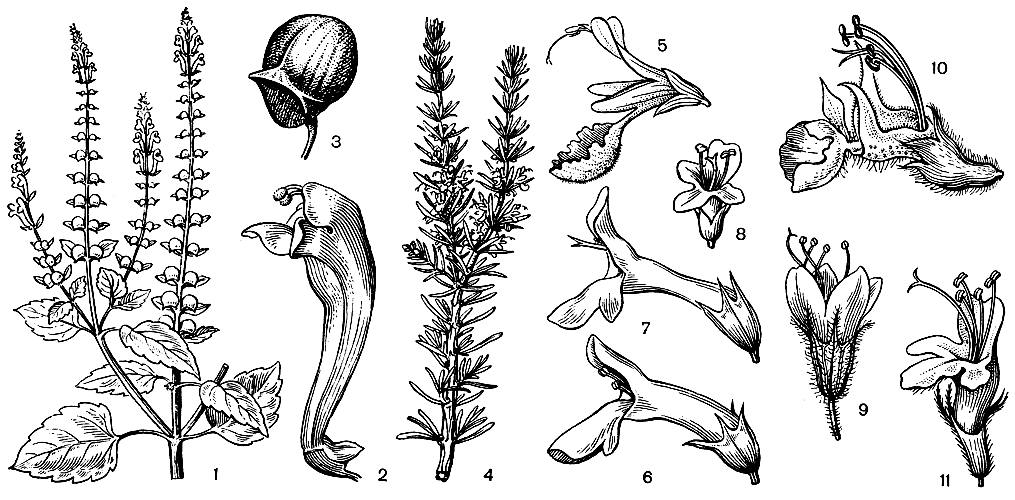
La racine principale reste souvent tout au long de la vie de la plante, moins souvent elle meurt et est remplacée par des racines adventives s'étendant soit à partir de la base de la tige, soit à partir de pousses souterraines rampantes qui en partent - des rhizomes, caractéristiques de nombreuses espèces de Lamiacées. Assez rarement parmi les Lamiacées, on trouve des espèces à drageons, par exemple Survivant de Genève(Ajuga gennevensis, tableau 55). Chez de nombreuses espèces côtières qui vivent dans des habitats gorgés d’eau, des cavités aériennes ou des zones de tissus aériens se forment dans les rhizomes. Certaines Lamiacées ont des racines tubéreuses et épaissies, qui sont utilisées comme aliment dans les pays tropicaux.

Avec des feuilles opposées, les paires proches alternent transversalement les unes avec les autres. La conséquence en est la nature tétraédrique des tiges des Lamiacées, et les bords peuvent être plats, convexes ou concaves. Parmi les Lamiacées, il existe peu d’espèces à feuilles verticillées. Il s'agit notamment du bush australien d'origine Westringie(Westringia) à petites feuilles entières, disposées en verticilles de 3 à 6 (Fig. 215). La disposition suivante des feuilles n'a été observée que dans les premières feuilles des semis des genres zopnik(Phlomis) et lettrine(Bétonica).
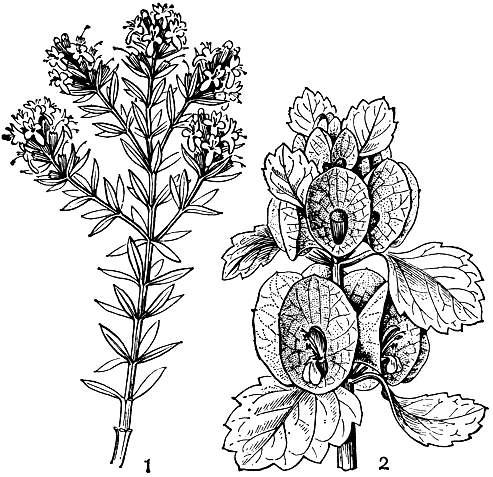
Les feuilles des Lamiacées sont généralement entières et souvent entières, bien que l'on trouve également des feuilles pennées divisées (par exemple, Salvia scabieuse- Salvia scabiosifolia). Connue comme espèce glabre ou presque glabre, comme les espèces ornementales salvia lucidum(S. splendens) et espèces densément couvertes de poils. Parmi ces dernières figurent des espèces méditerranéennes telles que Crétois propre(Stachys cretica) et Chemin de fer de Crimée(Sideritis taurica), ne sont pas inférieures en beauté au célèbre edelweiss alpin. Parmi les poils, les plus courants sont les poils simples multicellulaires. Les poils capités, dont la tête fonctionne comme une glande produisant de l'huile essentielle, se trouvent chez de nombreuses Lamiacées.
En règle générale, les fleurs à cinq chaînons et, en règle générale, bisexuées des Lamiacées sont situées à l'aisselle des feuilles qui sont inchangées ou modifiées en bractées. Ce n'est que dans quelques cas (par exemple chez les espèces de scutellaire) qu'elles sont solitaires ; généralement les fleurs forment ce qu'on appelle de faux verticilles, composés de deux inflorescences opposées portant des bractées. Les axes de toutes les inflorescences primaires, souvent considérablement raccourcis, et leurs fleurs constitutives semblent être situées directement à l'aisselle des feuilles, formant des inflorescences en forme d'épi. Parfois, l'axe de l'inflorescence générale est considérablement raccourci et l'inflorescence entière devient capitée, par exemple dans ziziphora capitée(Ziziphora capitata) et dans le grand genre américain hiptis. Pas rare dans les régions montagneuses d’Asie centrale bec-de-lièvre(Lagochilus) les bractées situées à la base des faux verticilles sont modifiées en de puissantes épines qui protègent la plante de la consommation des herbivores. Chez certaines autres Lamiacées, les bractées ou les feuilles supérieures, et parfois les dents des feuilles, sont transformées en épines.
Le calice et la corolle des Lamiacées sont généralement formés de 5 folioles fusionnées avec leur partie principale en un tube. Seuls quelques genres, comme le genre de la Méditerranée occidentale preslya(Preslia), ont un périanthe à quatre chaînons. Le calice des Lamiaceae peut avoir une grande variété de formes : tubulaire, en forme de cloche, en forme d'entonnoir, sphérique, et dans le pharynx, il peut être soit à deux lèvres sans dents, soit à 5(4) dents avec des dents du de longueurs identiques ou différentes (dans ce dernier cas, le calice est également plus ou moins bilobé). Contrairement à la corolle, dont les modifications sont associées à l'adaptation à la pollinisation, les modifications du calice sont généralement associées à l'adaptation à la répartition des fruits. Souvent (par exemple, dans l'agripaume), les dents du calice ont l'apparence d'épines courbées sur le côté. Parfois, le calice entier ou ses dents grandissent considérablement, augmentant la dérive du calice à mesure que les graines sont dispersées par le vent, ou le calice devient de couleur vive, jouant un rôle en attirant les insectes ou les oiseaux pollinisateurs, par exemple le calice rouge vif de Salvia splendor . Le calice du grand genre (environ 300 espèces), presque cosmopolite, Scutellaria, est très original. Ici, il a deux lèvres avec des lèvres extérieures entières et, une fois le fruit mûri, il se brise en 2 parties qui ressemblent à des valves : la partie inférieure restante et la partie supérieure tombant. La partie supérieure du calice de nombreuses espèces de ce genre porte également un pli transversal en forme d'écaille - le scutellum. Scutellaria présente un certain nombre d'autres caractéristiques qui distinguent ce genre des autres genres de Lamiaceae (y compris l'absence de glandes huileuses essentielles), et ce n'est pas un hasard si certains auteurs ont même proposé de le séparer en une famille spéciale des Scutellariaceae.
Comme mentionné ci-dessus, la corolle des Lamiacées est généralement divisée en deux lèvres, dont la supérieure est formée de 2 pétales et la inférieure de 3 pétales. La lèvre supérieure peut être plate ou convexe, parfois elle est entière, de sorte qu'aucune trace de la présence de 2 pétales n'est retrouvée. La lèvre inférieure est presque toujours plus grande (un site d'atterrissage pour les pollinisateurs), trilobée avec un lobe moyen plus grand et souvent à son tour bilobé. Parfois, ses lobes latéraux ont des appendices filiformes, comme Yasilyas(Lamium). Une structure assez originale de la corolle à l'accouchement forêt de chênes(Teucrium) et tenace(Ajuga, tableau 55). Le premier d'entre eux n'a aucune lèvre supérieure et les étamines, ainsi que le style, dépassent loin de la gorge de la corolle (Fig. 214). Cependant, les 2 lobes supérieurs, qui forment habituellement la lèvre supérieure, n'ont pas ici disparu, mais sont rattachés à la lèvre inférieure de la corolle, qui est composée non pas de 3, mais de 5 lobes. La lèvre supérieure tenace est très courte par rapport à la longue lèvre inférieure, et la corolle semble également être à une seule lèvre. U Basilique(Ocimum) et genres apparentés, la lèvre supérieure de la corolle est formée non pas de 2, comme d'habitude, mais de 4 pétales. La lèvre inférieure est constituée d'un seul pétale plat ou concave. Pour un parent du basilic fleur éperon(Plectranthus), pénétrant dans le sud de l'Extrême-Orient, se caractérise également par la présence d'un gonflement dans la partie inférieure du tube de la corolle, et chez certaines espèces ce gonflement se transforme en un véritable éperon. Certains genres de Lamiacées, dont Ziouznik(Lycopus, fig. 214), ont une corolle courte et presque actinomorphe à 4-5 lobes. La couleur des corolles des Lamiacées peut être rose, violette, lilas, bleue, jaune, blanche, souvent dans diverses combinaisons.
Il y a généralement 4 étamines dans les fleurs des Lamiacées, attachées au tube de la corolle. Dans un genre tropical coléus(Coleus, pl. 55) et chez certains genres apparentés, les filaments des étamines se développent ensemble pour former un tube court. Il existe parfois un rudiment d'une cinquième étamine, qui a probablement disparu suite à la transformation de la corolle actinomorphe en corolle zygomorphe au cours de l'évolution des Lamiacées. La paire d'étamines postérieures est généralement plus courte que la paire antérieure, mais parfois, par exemple dans herbe à chat(Nepeta), la relation inverse se produit. La menthe (Mentha), avec son périanthe presque actinomorphe, possède les 4 étamines presque de la même longueur. La réduction des étamines au sein de la famille va encore plus loin - jusqu'à 2 étamines, et 2 étamines postérieures sont réduites, restant parfois sous forme de staminodes. Deux étamines sont caractéristiques, par exemple, du genre méditerranéen romarin, sauge et du genre nord-américain-mexicain. monarde(Monarde). Sous le lieu de fixation des étamines se trouve souvent un anneau poilu - un dispositif de protection du nectar.

Les anthères des Lamiacées ont des formes différentes. Leurs nids sont généralement également développés, moins souvent l'un d'eux (généralement le devant) est moins développé que l'autre ou réduit. Chez de nombreuses espèces de sauge, la spécialisation des étamines est allée plus loin en raison de la très parfaite adaptation des fleurs à la pollinisation par certains insectes (fig. 216). Chacune des anthères des deux étamines présentes ici s'est transformée en une sorte de dispositif à levier, à une extrémité duquel se trouve un nid d'anthères supérieur entièrement développé, et à l'autre, un rudiment généralement en forme de cuillère du second (inférieur). nid d'anthère. Le filament, qui s'est développé en un long filament (une partie de l'étamine située entre les nids d'anthères), est attaché de manière mobile à un filament très court. La réduction complète de l'une des alvéoles d'anthère des deux étamines supérieures se produit également dans la calotte crânienne et l'anthère glandulaire, mais l'allongement du ligament ne se produit pas ici.
Les nectaires des Lamiacées proviennent de la base des carpelles. Le type de nectaire le plus courant est un disque à 4 lobes ou dents. Chaque lobe peut sécréter du nectar, mais cette capacité dépend du degré de développement des lobes eux-mêmes et de leur système conducteur. Les insectes trouvent du nectar sous l'ovaire dans la partie inférieure de la corolle, mais lorsque le nectar est libéré en abondance, il remplit uniformément toute la partie inférieure du tube de la corolle et l'insecte n'a qu'à abaisser sa trompe dans le tube pour récolter beaucoup de nectar. . Dans la calotte, le disque solide nectarifère est généralement remplacé par un nectaire en forme de fer à cheval comportant 3 à 5 lobes inégaux.
La structure du gynécée de toutes les Lamiacées a beaucoup en commun. Il est toujours formé de deux carpelles avec un nombre de nids correspondant au nombre de carpelles. Cependant, chacun des nids est divisé en deux par une fausse cloison, ce qui fait que l'ovaire devient quadrilobé, avec un ovule dans chaque lobe. Le style de la plupart des Lamiacées s'étend à partir de la base des lobes de l'ovaire (gynobasique), mais dans les sous-familles Ajugoideae et Prostantheroideae, il n'est généralement pas complètement gynobasique ou s'étend même presque depuis le sommet de l'ovaire, comme dans la famille des verveines. Dans la calotte, l'ovaire n'est pas sessile, comme chez les autres Lamiacées, mais est situé sur une tige formée par la partie inférieure fortement rétrécie du gynécée.
Bien que les fleurs des Lamiacées soient généralement bisexuées, dans de nombreux genres (par exemple, menthe, thym - Thymus), il existe également des fleurs femelles avec des étamines rudimentaires, ayant généralement une corolle plus petite et de couleur pâle. Les fleurs mâles avec un gynécée rudimentaire sont beaucoup moins courantes (par exemple chez certaines espèces d'herbe à chat). Des fleurs cléistogames avec une corolle qui ne dépasse pas du calice et ne tombe généralement pas peuvent être vues sur une mauvaise herbe annuelle commune dans de nombreuses régions de l'URSS. fermoir entourant la tige(Lamium amplexicaule). Ces fleurs se forment généralement dans des conditions climatiques défavorables : début du printemps ou fin de l'automne.
Le fruit des Lamiacées est constitué de 4 lobes à une seule graine et pour la plupart en forme de noix, ayant des formes très différentes. Lors de la fructification, la corolle tombe généralement (mais reste dans les fleurs cléistogames et dans certains genres de la sous-famille tenace), et le calice reste toujours et grandit souvent (en particulier chez les espèces du genre molucelle(Molucella, voir Fig. 215) et hymencratère(Hyménocratère). L'endosperme est généralement absent des graines matures et est rarement conservé, ce qui constitue une caractéristique primitive. L'endosperme le plus développé se trouve dans les espèces de la sous-famille australienne des Prostanteraceae et dans le genre tétrachondra(Tétrachondra). La membrane externe des lobes fœtaux porte souvent des tubercules, des papilles ou des poils, associés à leur mode de propagation.
Selon les dernières données, la famille des Lamiacées compte environ 200 genres et 3 500 espèces, répartis presque partout dans le monde. Les lamiacées sont particulièrement nombreuses dans les pays à flore méditerranéenne ancienne - des îles Canaries à l'Himalaya occidental, où elles jouent souvent un rôle de premier plan dans les groupes végétaux. Les Lamiacées sont presque totalement absentes de l'Arctique et de l'Antarctique. Il y a très peu de Lamiacées dans la zone de la taïga. Les régions montagneuses des tropiques, notamment d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud, sont assez riches en Lamiacées. En Australie, les genres de la sous-famille des Prostanteraceae sont majoritairement endémiques à ce continent (6 genres et environ 100 espèces). La Nouvelle-Zélande est encore plus pauvre en Lamiacées, où il n'existe qu'une seule espèce de scutellaire et de menthe (toutes deux endémiques) et une des deux espèces du genre très particulier Tetrachondra (la deuxième espèce se trouve en Patagonie). Le genre Tetrachondra est parfois classé comme une famille distincte. Les îles hawaïennes sont relativement riches en Lamiaceae, avec 2 genres endémiques de la sous-famille des Prasiaceae à prédominance tropicale.
Parmi les Lamiacées, les xérophytes des hautes et basses terres prédominent dans les habitats secs et ouverts, mais parmi elles, on trouve également de nombreuses plantes mésophiles des forêts et des prairies. Seules quelques espèces sont représentées dans les forêts tropicales humides. Il n'existe pas de véritables plantes aquatiques parmi les Lamiacées, mais il existe plusieurs genres dont de nombreuses espèces vivent le long des berges des réservoirs et dans les marécages. Tels sont par exemple les genres très répandus menthe, zyuznik et scutellaire.
Les relations des Lamiacées avec leurs insectes pollinisateurs (et en Amérique tropicale et subtropicale également avec les colibris) sont très complexes et sont le résultat d'une longue évolution conjuguée. Les espèces des genres aux fleurs les plus simplement disposées, ayant une corolle presque régulière avec un tube court et 4 étamines de longueur presque égale (par exemple, la menthe, voir Fig. 214) sont généralement pollinisées par de petits hyménoptères et des mouches, puisque le nectar en eux sont facilement accessibles. Chez la plupart des autres Lamiacées à corolle à double lèvre bien définie, les étamines et le style sont adjacents à la lèvre supérieure, et le nectar est placé dans la partie inférieure d'un tube assez long. Les pollinisateurs de ces fleurs sont principalement des hyménoptères et des papillons, moins souvent de grosses mouches de la famille des syrphes. Les visiteurs d'une fleur touchent d'abord le stigmate, puis les anthères, et emportent une partie du pollen qui s'y trouve. Dans le fermoir et dans certains autres genres, la libération de pollen sur le dos de l'insecte est facilitée par la présence de poils orientés vers le bas sur les anthères, que l'insecte touche. Des dispositifs remarquables, comme un levier ou une barrière, qui permettent l'accès au nectar seulement après que le pollen soit tombé sur le dos de l'insecte, se retrouvent chez les espèces de Zopnik et Tchernogolovka(Prunella), cependant, ils atteignent la plus grande perfection chez les espèces de sauge, dans lesquelles les anthères des deux étamines existantes sont transformées en de particuliers dispositifs à levier mobiles (voir ci-dessus). L'insecte pollinisateur, afin d'obtenir du nectar, enfonce sa tête dans le tube de la corolle, pousse le rudiment expansé en forme de cuillère du nid d'anthère inférieur vers l'intérieur et vers le haut, et le nid d'anthère fertile, situé à l'autre extrémité du conjonctif allongé, frappe le dos de l'insecte, déversant du pollen dessus (voir Fig. 216) . Les Lamiacées américaines des genres Salvia, Scutellaria, Monarda et autres ont souvent de grandes fleurs rouges pollinisées par de grands papillons de nuit et des colibris. Ces derniers, comme les papillons de la famille des sphinx, planent près des fleurs, sucent le nectar avec leur bec et touchent de la tête les stigmates et les étamines situées sous la lèvre supérieure ou dépassant de la corolle.
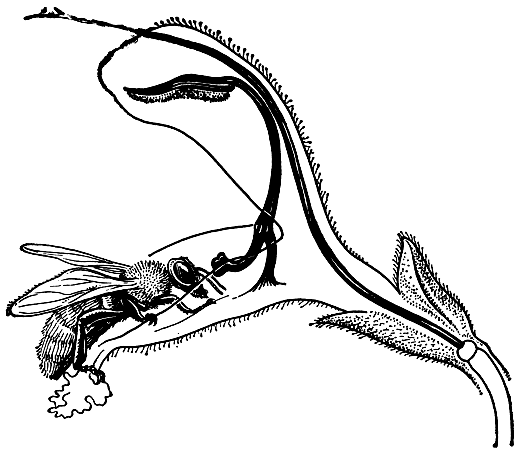
Chez certaines Lamiaceae (en particulier les genres de la sous-famille des Basilaceae), les étamines et le style sont placés sur la lèvre inférieure, de sorte que l'insecte visitant la fleur (généralement des papillons) emporte le pollen sur la face inférieure de l'abdomen. Chez d'autres genres de Lamiacées, le même effet (position inférieure des étamines et du style) est obtenu grâce à la torsion du tube de la corolle (la lèvre supérieure devient comme une lèvre inférieure), à la torsion du pédoncule et à une inflorescence fortement tombante (par exemple , chez la sauge tombante - S. nutans, les inflorescences fleuries sont inversées de haut en bas). La possibilité d'autopollinisation des fleurs de Lamiacées est souvent éliminée en raison de la maturation plus précoce des étamines par rapport au stigmate (protandrie), mais dans de nombreux autres cas, l'autopollinisation est tout à fait possible. Il convient de noter que chez de nombreuses Lamiacées, non seulement la corolle, mais aussi d'autres parties de la fleur et de l'inflorescence participent à l'attraction des insectes et des oiseaux. Ainsi, la sauge brillante a des coupes rouge vif, et sauge de chêne(S. nemorosa) - bractées bleu-violet.
De nombreuses Lamiacées se propagent par le vent (anémochorie). Les unités de distribution - les diaspores - dans ce cas sont généralement des parties à graine unique d'un fruit fractionné, dont la dérive peut augmenter en raison de leur pilosité ou de la formation d'excroissances en forme d'aile ou de touffe. Ainsi, dans un genre répandu en Afrique tropicale acouphène Les fruits (Tinnéa) ont des boucliers en forme de touffe. Chez les Lamiacées anémochores, les tiges restent souvent sèches longtemps, dispersant progressivement les fruits (même en hiver). Dans d'autres cas, au contraire, les tiges ramifiées évasées aux inflorescences fruitières se cassent facilement à leur base et roulent sur la steppe avec le vent, dispersant progressivement les fruits. Ces tumbleweeds sont certains types de sauge, de zopnik, d'herbe à chat, etc. Plus les fruits ne tombent pas longtemps des tasses, plus la distance sur laquelle ils seront transportés est grande. Ainsi, de nombreuses Lamiacées possèdent des dispositifs permettant de maintenir les fruits dans le calice : un anneau de poils dans son pharynx ou des dents recourbées vers l'intérieur.
Chez de nombreuses Lamiacées anémochores, les lobes du fruit tombent avec le calice. Dans ces cas, la dérive est obtenue soit en raison des dents relativement longues et souvent ciliées du calice (par exemple, dans thym- Thymus), ou encore en raison de la forte croissance du tube du calice et de ses dents. Oui, oui molucelle(Molucella) le tube du calice des fruits est considérablement élargi, membraneux et largement en forme de cloche (voir Fig. 214), tandis que chez le bec-de-lièvre, au contraire, les dents du calice augmentent considérablement en largeur.
Chez certaines espèces otostégie(Otostegia) le rôle de la mouche est joué par la lèvre supérieure membraneuse très élargie du calice, et chez l'Algérien saccocalix(Saccocalyx satureioides) le calice du fruit est gonflé en forme de bulle avec un pharynx fermé, ce qui permet au fruit qu'il contient d'être transporté par le vent sur de longues distances.
Parmi les Lamiacées, il existe de nombreuses espèces qui se propagent à l'aide d'animaux, et les adaptations à la zoochorie ne sont pas moins diverses. De nombreuses Lamiacées ont des membranes mucilagineuses des lobes des fruits lorsqu'elles sont mouillées et peuvent se propager à la fois par endozoochore (avec l'aide d'animaux frugivores, principalement des oiseaux) et par épizoochore (sur la laine et les plumes, ainsi que sur les pattes des animaux et des humains). Une plus grande efficacité de l'endozoochorie est obtenue grâce à la formation de lobes de fruit en forme de drupe avec une coquille charnue juteuse (dans le genre méditerranéen Prasium). Dans la famille hoslundia(Hoslundia) d'Amérique tropicale, le calice devient charnu (en forme de baie) lors de la fructification, dont la gorge est fermée par des dents. Les espèces à lobes de fruits adhésifs ou poilus se propagent de manière épizoochore. Dans de nombreux cas, la propagation épizoochorique est également facilitée par la chute des calices avec les fruits, les poils durs et les dents dures dépassant sur les côtés, qui constituent un excellent dispositif d'ancrage dans la fourrure animale.
Les fruits de certaines Lamiacées (en particulier les espèces de poissons tenaces et de demoiselles) ont des appendices disposés de diverses manières qui servent de nourriture aux fourmis. Ils se caractérisent par le mode de distribution dit myrmécochore. Vue brésilienne Glaçage hiptis(N. glasiovii) appartient généralement aux plantes « aimant les fourmis » (myrmecophiles) : dans les entre-nœuds gonflés de ses tiges se trouvent constamment des colonies de fourmis spéciales.
Les espèces de Lamiacées qui vivent près des rives des plans d'eau et dans les marécages (par exemple, les espèces de menthe et de sauterelle) ont des lobes de fruits flottants, adaptés à la dispersion par les courants d'eau, mais en partie aussi par les animaux aquatiques.
Le système des Lamiacées est encore loin d’être parfait et est en cours de développement. Tout d’abord, la frontière qui sépare les Lamiacées de la famille des Verbénacées, étroitement apparentée mais plus primitive, n’est pas encore tout à fait claire. Ainsi, certains auteurs proposent de classer deux sous-familles de Lamiacées comme verveines, qui sont similaires dans la structure du gynécée à de nombreux genres de verveines - les prostantéracées et tenaces ; d'autres, au contraire, proposent de transférer une partie importante de la famille des verveines aux Lamiacées. Selon l'un des derniers systèmes de la famille des Lamiacées, développé par le botaniste allemand H. Melchior (1964), elle est divisée en 9 sous-familles. La première place parmi elles est occupée par la sous-famille australienne des Prostantheroideae, qui se distingue par la structure relativement primitive du gynécée et des graines avec endosperme, mais ayant une structure de périanthe assez hautement spécialisée. Vient ensuite la sous-famille tenace (Ajugoideae), qui possède un gynécée comme les prostantheridés, mais des graines sans endosperme. Cela inclut les naissances de survivants, forêt de chênes(Teucrium), améthystea (Amethystea), etc. Le genre est attribué à une sous-famille monotypique spéciale du romarin (Rosmarinoideae) Romarin(Rosmarinus, tableau 55) à corolle prononcée à deux lèvres, 2 étamines et graines sans endosperme (voir Fig. 214).
La sous-famille suivante, les basilaceae (Ocimoideae), comme toutes les sous-familles ultérieures, diffère des sous-familles précédentes par un gynécée plus spécialisé avec une colonne gynobasique clairement définie. Il y a 4 étamines, rarement 2. Les représentants de cette sous-famille sont répartis presque exclusivement dans les pays tropicaux et subtropicaux. Le plus grand genre, Hyptis, contient plus de 350 espèces, réparties principalement en Amérique du Sud et centrale. Ce genre comprend les arbres les plus hauts parmi les Lamiacées, poussant dans les forêts du Brésil. Le genre Hyptis comprend deux espèces économiquement importantes : hiptis spica(H. spicigera), cultivé pour ses graines afin de produire une huile semblable à celle du sésame, et hiptis odorant(H. suaveolens), ou « sangura », produit un thé médicinal très aromatique. Genre basilic(Ocimum) compte jusqu'à 150 espèces, réparties dans les pays tropicaux et subtropicaux, notamment en Afrique. Ce genre comprend basilic noble(O. basilicum), originaire d'Asie tropicale, cultivée dans de nombreux pays, y compris dans le sud de l'URSS, comme plante épicée. En Chine, la culture de cette plante est connue depuis 500 avant JC. e. Un autre représentant célèbre de ce genre est basilic eugénola(O. gratissimum) - un arbuste originaire d'Asie tropicale, cultivé notamment ici en Géorgie et dans les régions méridionales du territoire de Krasnodar comme plante à huile essentielle. Aussi célèbre basilic sacré(O. sanctum) est un arbuste paléotropical cultivé en Inde et dans d'autres pays comme plante cultivée. Genre fleur éperon(Pleetranthus) comprend environ 250 espèces, réparties dans les pays tropicaux et subtropicaux de l'Ancien Monde. Un certain nombre d'espèces de ce genre atteignent le nord du Japon et les régions méridionales de l'Extrême-Orient. Il convient enfin de mentionner le genre paléotropical Coleus (tableau 55, environ 150 espèces). Certains types, notamment coléus comestible(C. edulis), ont des racines féculentes, tubéreuses et épaissies et sont cultivées comme plantes alimentaires sous les tropiques de l’Ancien Monde. De nombreuses espèces sont ornementales et certaines sont cultivées à l’intérieur et dans les jardins. Espèce indo-malaise Coleus amboinensis(C. amboinicus) sont utilisées comme assaisonnement pour les aliments, et les racines de Coleus vétitiverioides(C. vettiverioides) sont utilisés pour diverses décorations. La sous-famille des Catopheriaceae (Catopherioideae) ne comprend qu'un seul genre catophérie(Catopheria, 3 espèces), répartie du Mexique à la Colombie. Les types de catophérie sont des plantes d'apparence très originale, caractérisées par un embryon avec une racine succulente adjacente aux cotylédons.
La sous-famille de la lavande (Lavanduloideae) ne contient également qu'un seul genre de lavande (Lavandula). Le genre lavande, qui compte environ 28 espèces, est réparti principalement en Méditerranée et en Macaronésie, mais son aire de répartition s'étend jusqu'en Somalie en Afrique et en Inde. Cela inclut les sous-arbrisseaux et les arbustes. Certaines espèces sont utilisées depuis l’Antiquité pour obtenir de précieuses huiles essentielles. Lavande angustifolia(L. angustifolia) - un arbuste atteignant 1 m, et parfois jusqu'à 2 m de haut, largement cultivé pour obtenir de précieuses huiles essentielles et est également très populaire comme plante ornementale. Les huiles essentielles sont également obtenues à partir de Lavande latifoliée(L. latifolia) et quelques autres espèces. Les fleurs et les feuilles séchées de lavande conservent longtemps un parfum épicé et sont utilisées pour éloigner les mites. La sous-famille suivante, Prasioideae, comprend 6 genres, répartis principalement en Asie tropicale. Un seul genre monotypique prasium(Prasium) se trouve en Méditerranée, du Portugal à la Yougoslavie. Prasium, comme d'autres représentants de la sous-famille, se caractérise par des lobes de fruit en forme de drupe.
La grande majorité des Lamiaceae extratropicales appartiennent à la vaste sous-famille des Lamioideae, Melchior l'appelle Stachyoideae. Parmi les représentants de cette sous-famille, le genre doit d'abord être nommé pogostemon(Pogostemon) avec environ 40 espèces, réparties en Chine et en Asie tropicale. Ce genre appartient patchouli(P. cablin) est une plante très aromatique originaire des Philippines. Elle est largement cultivée dans les pays tropicaux pour son huile essentielle. L'huile de patchouli possède des propriétés bactéricides et est largement utilisée en parfumerie et en médecine. Les représentants utiles de la sous-famille comprennent également 5 espèces du genre pérille(Perilla), commune en Asie du Sud, de l’Est et du Sud-Est. Buisson de périlla(P. frutescens) est cultivée en Asie de l’Est comme plante oléagineuse et médicinale, et périlla frisée(P. frutescens var. crispa) aux feuilles violettes foncées et frisées est très décorative et est cultivée en Chine et au Japon comme plante oléagineuse, huile essentielle et salade. Le sexe est encore plus important menthe(Mentha, environ 25 espèces dans la zone tempérée de l'hémisphère nord, Afrique du Sud et Australie). Les fleurs des espèces de menthe sont presque actinomorphes, à quatre chaînons, avec 4 étamines presque identiques. Certains types de menthe, en particulier menthe poivrée hybride(M. piperita), sont largement cultivées comme plantes médicinales et alimentaires précieuses (comme assaisonnement). Les huiles de menthe poivrée, qui contiennent des quantités importantes de menthol ainsi que de nombreux autres composants, sont ajoutées à de nombreux médicaments, bonbons et dentifrices. Hysope officinale(Hyssopus officinalis) est également cultivée comme huile essentielle, plante médicinale et ornementale. Les espèces du genre Origanum (Origanum) revêtent également une certaine importance. Environ 15 à 20 espèces de ce genre sont connues, réparties en Europe, dans les régions méditerranéennes et tempérées d'Asie. Origan(O. vulgare) est utilisée comme plante médicinale et ses feuilles sont utilisées comme épice et assaisonnement pour l'alimentation et dans l'industrie de la distillerie. Largement cultivé marjolaine(O. majorana), avec plusieurs espèces apparentées, est parfois classée comme un genre distinct Majorana. La patrie de la marjolaine est l’Asie du Sud-Ouest et l’Afrique du Nord. Les feuilles de marjolaine sont utilisées comme épice pour divers plats et pour ajouter de la saveur au vinaigre et au thé. L'huile essentielle est extraite des feuilles et des fleurs. L'un des représentants les plus célèbres de la famille est le genre thym(Thymus), comptant de 35 à 400 espèces, selon le point de vue du taxonomiste sur la taille de l'espèce. Les feuilles de thym contiennent des huiles essentielles, principalement du thymol, utilisées en médecine. Les feuilles sont utilisées comme épice dans les industries des conserves et des boissons alcoolisées. méditerranéen thym commun(T. vulgaris) est largement cultivé dans les pays tempérés et tropicaux. Des espèces du genre sont également utilisées Mélisse(Melissa, 5 espèces en Eurasie). Mélisse officinale, ou Mélisse(M. officinalis), cultivée comme huile essentielle, plante mellifère et épicée. Proche de la mélisse se trouve le genre sarriette (Satureja), qui compte jusqu'à 200 espèces, commune dans les régions tempérées et subtropicales. Sarriette du jardin(S. hortensis) est cultivée comme plante à huile essentielle. Il est utilisé comme épice, en médecine et en parfumerie, ainsi que pour aromatiser les liqueurs et les cognacs. Enfin, sarriette des montagnes(S. montana) est cultivée comme plante ornementale.
Chistets(Stachys) est l'un des grands genres de la sous-famille, comptant environ 300 espèces, réparties dans les régions tempérées, subtropicales et tropicales, mais absentes toutefois en Australie et en Nouvelle-Zélande. Certaines espèces de chistets jouent un rôle notable dans la composition du couvert végétal (tableau 55). Parmi les espèces utiles, il convient de mentionner ce qu'on appelle artichaut chinois(S. affinis), introduite en culture en Chine et actuellement également cultivée au Japon, en Belgique et en France comme plante potagère pour ses rhizomes tubéreux comestibles. Plusieurs espèces de chistema sont cultivées comme plantes ornementales.
La sauge est le plus grand genre de la famille des Lamiacées. Le nombre d’espèces de sauge atteint 700 et elles sont largement réparties dans les régions tempérées, subtropicales et tropicales. Certaines espèces de sauge jouent un rôle prédominant dans le couvert végétal. Largement cultivé et bien connu de tous Salvia officinalis(S. officinalis). La sauge brésilienne à coupe et corolle rouge vif est devenue une plante ornementale très appréciée dans les jardins et les parcs. look mexicain salvia narcotique(S. divinorum) contient des substances qui ont un effet narcotique, connu des anciens Mexicains. Au Pérou, elle était considérée comme une fleur sacrée sauge à fleurs opposées(S. oppositiflora) - arbuste à fleurs rouges de 2,5 à 3 cm de long.
Parmi les autres représentants médicinaux de cette sous-famille, nous indiquons également agripaume(Leonurus hearta) - un remède cardiaque bien connu, encensoir(Melittis melissophyllum), espèce de ziziphora(Ziziphora), bec-de-lièvre.
La dernière place du système Melchior est occupée par la sous-famille des Scutellarioideae, la plus spécialisée dans la structure des fleurs. Cette sous-famille ne comprend que deux genres : le grand genre calotte(Scutellaria), comptant environ 300 espèces, très largement réparties dans le monde entier (à l'exception de l'Afrique du Sud), et le genre monotypique Salazaria, réparti aux États-Unis et au Mexique.
Plus naturel par rapport au système Melchior est le système des Lamiaceae, proposé en 1967 par R. Wunderlich. Elle repose principalement sur la structure des fruits et des grains de pollen, et a été récemment confirmée par des données de chimiotaxonomie. Wunderlich n'accepte que 6 sous-familles : Prostanteraceae, Tenacious, Scutellaceae, Chistacées, Sarriette (Saturejoideae) et Catopheriaceae. Elle combine la sous-famille des Prasiaceae Melchior avec les Chistetsaceae, et les sous-familles Rosemaryaceae et Lavenderaceae avec la sous-famille savoureuse qu'elle distingue des Chistetaceae. Les basilacées de Melchior rejoignent également la famille des sarriettes Wunderlich, mais occupent une place à part dans cette sous-famille. Bien que le système phylogénétique de Wunderlich présente plusieurs avantages, il subira sans aucun doute d’autres changements.
Famille des marais (Callitrichaceae)
À la surface des petits plans d’eau peu profonds, on peut souvent voir des rosettes de petites feuilles elliptiques se terminant par des tiges fines et flexibles. Ce marais marais(Callitriche palustris) est l'espèce la plus répandue d'un seul genre de la famille des bourbiers (Fig. 217). Le marécage est souvent appelé étoile d'eau, car ses rosettes de feuilles flottantes ressemblent vraiment à une belle étoile à rayons multiples. Comme beaucoup d'autres espèces de ce genre, la tourbière des marais se distingue par un grand polymorphisme, évoluant fortement sous l'influence diverses conditions un habitat. La forme la plus courante pousse dans l'eau à une profondeur de 30 à 40 cm. Ses tiges sous l'eau ont des entre-nœuds assez longs et des feuilles translucides linéaires, et à la surface de l'eau - des entre-nœuds proches et beaucoup plus larges (elliptiques ou obovales) flottantes vert vif. feuilles, formant une rosette. Dans les endroits plus profonds, les tiges du marécage n'atteignent pas la surface de l'eau et ne portent que des feuilles sous-marines. Sous cette forme, il n'est pas facile de le reconnaître. Mais la forme terrestre de la tourbière est encore plus différente. Il s'agit d'une plante naine (jusqu'à 5 cm de haut) avec des tiges couchées qui s'enracinent au niveau des nœuds et de très petites feuilles étroitement elliptiques ou largement linéaires. La forme terrestre se comporte généralement comme une annuelle, bien que des individus de formes aquatiques (en particulier dans les eaux plus profondes) puissent exister pendant plusieurs années. Représentants d'une section plus spécialisée pseudocallitriche(Pseudocallitriche) n'en ont qu'un, sous l'eau forme de vieà feuilles translucides larges et linéaires, comme les autres espèces du genre, toujours opposées et sans stipules.
Les fleurs unisexes mais monoïques de l'herbe des tourbières sont situées une ou deux à l'aisselle des feuilles supérieures et souvent médianes sur des pédicelles très courts, moins souvent plus longs. A leur base se trouvent souvent 2 bractées membraneuses arquées. En raison du passage à la pollinisation par l'eau ou le vent, les fleurs sont totalement dépourvues du périanthe, si bien développé dans les proches familles entomophiles des Verbénacées et des Lamiacées. Chaque fleur femelle est représentée par un gynécée syncarpe de 2 carpelles à 2 styles filamenteux, qui se transforment également en stigmates filamenteux. L'ovaire est principalement biloculaire, mais chacune des deux alvéoles est divisée par un faux septum en 2 parties supplémentaires, dont chacune contient un ovule anatropique pendant. La fleur mâle est constituée d'une étamine. A l'aisselle des feuilles il peut y avoir 1, moins souvent 2 fleurs du même sexe, et souvent différents genres(dans ce dernier cas, les fleurs unisexuées peuvent facilement être confondues avec une fleur bisexuée).
Les grains de pollen des bourbiers sont sphériques ou ellipsoïdaux avec une coquille à 3 (4) sillons ou sans ouverture. Chez les espèces pollinisées au-dessus ou à la surface de l'eau, les grains de pollen ont une fine exine avec une sculpture de très petites verrues, tandis que chez les espèces à pollinisation sous-marine, l'exine est complètement absente. Après maturation, les fruits se divisent en 4 (moins souvent 2 ou 3) lobes à une seule graine.
Bien que le genre Mireweed ne compte qu'une vingtaine d'espèces, il, comme beaucoup d'autres espèces aquatiques et plantes côtières, est très répandu, presque cosmopolite (tableau 55). Les espèces de ce genre ne sont absentes que dans les hautes latitudes de l'Arctique, ainsi que dans certains déserts et hautes terres, bien que espèce individuelle ils s'élèvent dans les montagnes jusqu'à 3 500 m. Les marécages se trouvent principalement dans des réservoirs stagnants et à débit lent. Marais bisexuel(C. hermaphroditica, Fig. 217), comme certaines autres espèces de la section pseudocallitriche, qui n'ont qu'une forme sous-marine, tolèrent les eaux légèrement saumâtres et poussent souvent en abondance sur les fonds sableux et vaseux des baies marines dessalées par les rivières en profondeur. de 0,3 à 2 m. D'autres espèces se trouvent également souvent en grands groupes, remplissant de petits plans d'eau.

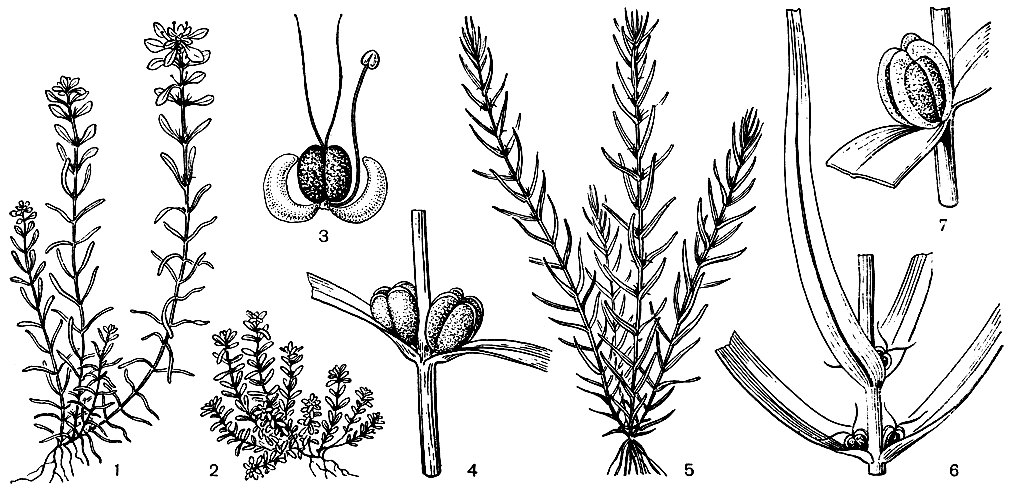
Les formes terrestres naines de marais et de nombreuses autres espèces d'amphibiens de ce genre se développent généralement sur le site de réservoirs à séchage rapide, sur ce que l'on appelle les puits profonds.
Les habitants des marais disposent de 2 méthodes connues de pollinisation : au-dessus de l'eau et sous l'eau. Chez la plupart des espèces, les anthères reposent sur des filaments relativement longs et des stigmates filiformes dépassent de l'eau dans la partie médiane des rosettes de feuilles flottantes. Après l'ouverture des anthères, les grains de pollen tombent en partie à la surface de l'eau, en partie sont dispersés par le vent et, dans les deux cas, peuvent très bien se retrouver sur la surface réceptrice des stigmates. Sous l'eau, ces espèces ne forment généralement pas de fleurs, bien que la maturation de leurs fruits se produise généralement déjà sous la surface de l'eau.
Chez les espèces à pollinisation sous-marine, auxquelles appartiennent obligatoirement les espèces sous-marines, les sections pseudocallitriches, ainsi que la forme aquatique mirweed crochu(Callitriche hamulata), les grains de pollen libérés par l'anthère sont transportés par les courants d'eau ou de longs stigmates filamenteux sont en contact direct avec l'anthère ouverte. Dans ce dernier cas, les cas de pollinisation des fleurs femelles avec le pollen des fleurs mâles d'une même pousse sont particulièrement fréquents. Lors de la pollinisation sous-marine, les tubes polliniques commencent à se former peu de temps après que les grains de pollen entrent dans l'eau, ce qui augmente considérablement les chances de contacts réussis avec les stigmates. Fait intéressant, dans la forme terrestre naine de la fange crochue, la pollinisation se produit également sous l'eau : soit lors d'inondations temporaires des plantes avec de l'eau, soit dans les gouttes d'eau de pluie retenues à l'aisselle des feuilles. Cependant, la forme terrestre de la tourbière marécageuse, plus répandue, se reproduit de manière apogame, formant un grand nombre de fruits sans aucune pollinisation. Ses fleurs ne présentent généralement que des rudiments de gynécée et des anthères sous-développées, sans grains de pollen ou avec quelques grains ratatinés.
Les parts de fruits en décomposition de l’herbe de l’herbe sont distribuées principalement par les écoulements d’eau permanents ou temporaires. Très souvent, des portions de fruits sont transportées sur les pattes d'animaux (y compris d'oiseaux) et d'humains, comme en témoigne la présence fréquente d'herbes des marais sur les sections basses des routes et des sentiers. U Bolotnik Naftolski(C. naftolskyi) et quelques autres espèces à pédicelles longs, on note une géocarpie : après la floraison, les pédicelles se courbent et s'allongent fortement, plongeant les fruits mûrissants dans le limon ou le sable.
Selon les dernières données, la famille des Lamiacées compte environ 200 genres et 3 500 espèces, répartis presque partout dans le monde. Les Lamiacées sont presque totalement absentes de l'Arctique et de l'Antarctique. Il y a très peu de Lamiacées dans la zone de la taïga. Les zones montagneuses des tropiques sont assez riches en Lamiacées.
Parmi les Lamiacées, les xérophytes des hautes et basses terres prédominent dans les habitats secs et ouverts, mais parmi elles, on trouve également de nombreuses plantes mésophiles des forêts et des prairies. Seules quelques espèces sont représentées dans les forêts tropicales humides. Il n'existe pas de véritables plantes aquatiques parmi les Lamiacées, mais il existe plusieurs genres dont de nombreuses espèces vivent le long des berges des réservoirs et dans les marécages. Tels sont par exemple les genres très répandus menthe, zyuznik et scutellaire.
La plupart des Lamiacées sont des herbes et des arbustes. Cependant, parmi eux, notamment dans les régions tropicales et subtropicales, on trouve également de nombreux arbustes. Lamiacées - les arbres ne se trouvent que sous les tropiques.
La racine principale reste souvent tout au long de la vie de la plante, moins souvent elle meurt et est remplacée par des racines adventives s'étendant soit à partir de la base de la tige, soit à partir de pousses souterraines rampantes qui en partent - des rhizomes, caractéristiques de nombreuses espèces de Lamiacées. Assez rarement parmi les Lamiacées, on trouve des espèces à drageons. Chez de nombreuses espèces côtières qui vivent dans des habitats gorgés d'eau, des cavités aériennes ou des zones de tissus aérogènes se forment dans les rhizomes. Certaines Lamiacées ont des racines tubéreuses et épaissies, qui sont utilisées comme aliment dans les pays tropicaux. Avec des feuilles opposées, les paires proches alternent transversalement les unes avec les autres. La conséquence en est la nature tétraédrique des tiges des Lamiacées, et les bords peuvent être plats, convexes ou concaves. Parmi les Lamiacées, il existe peu d’espèces à feuilles verticillées.
Les caractéristiques distinctives importantes des Lamiacées comprennent des feuilles opposées (très rarement verticillées), généralement entières sans stipules et des tiges généralement tétraédriques.
Les tiges des Lamiacées herbacées sont généralement dressées et ne nécessitent pas de support, bien qu'il existe des espèces dont les tiges rampent le long du sol et s'enracinent dans les nœuds (par exemple, bourgeon en forme de lierre - Glechoma hederacea). Chez la plante grimpante rampante (Ajuga reptans), en plus des pousses reproductrices dressées, à l'aisselle des feuilles de la rosette, se forment des pousses végétatives arquées dirigées vers le sol et enracinées au sommet, semblables aux vrilles du fraisier. Une rosette bien développée de feuilles basales, conservées lors du tissage de la plante, se retrouve chez de nombreuses Lamiacées herbacées.
Les feuilles des Lamiacées sont généralement entières et souvent entières, bien que pennées. On connaît à la fois des espèces nues ou presque nues et des espèces densément couvertes de poils. Parmi les poils, les plus courants sont les poils simples multicellulaires. Les poils capités, dont la tête fonctionne comme une glande produisant de l'huile essentielle, se trouvent chez de nombreuses Lamiacées.
Les représentants de cette famille sont facilement reconnaissables à la structure de la corolle des fleurs, qui possède un long tube et un pharynx à deux lèvres, rappelant la gueule béante d'un animal de conte de fées. Bien qu'une corolle d'apparence similaire se trouve dans plusieurs autres familles de plantes à fleurs (par exemple chez de nombreuses Norichacées), elle est particulièrement caractéristique des Lamiacées. Généralement, les fleurs à 5 chaînons et, en règle générale, bisexuées des Lamiacées sont situées à l'aisselle des feuilles inchangées ou modifiées en bractées. Ce n'est que dans quelques cas (par exemple dans la calotte) qu'elles sont solitaires ; généralement les fleurs forment ce qu'on appelle de faux verticilles, composés de deux inflorescences opposées portant des bractées. Les axes de toutes les inflorescences primaires, souvent considérablement raccourcis, et leurs fleurs constitutives semblent être situées directement à l'aisselle des feuilles, formant des inflorescences en forme d'épi. Parfois, l'axe de l'inflorescence générale est considérablement raccourci et l'inflorescence entière devient capitée.
Le calice et la corolle des Lamiacées sont généralement formés de 5 folioles fusionnées avec leur partie principale en un tube. Seuls quelques genres ont un périanthe à quatre chaînons. Le calice des Lamiacées peut avoir une grande variété de formes : tubulaire, en forme de cloche, en forme d'entonnoir, sphérique, et dans le pharynx, il peut être soit à deux lèvres sans dents, soit à 5 (4) dentées avec des dents identiques. ou de longueurs différentes (dans ce dernier cas, le calice est également plus ou moins bilobé). Contrairement à la corolle, dont les modifications sont associées à l'adaptation à la pollinisation, les modifications du calice sont généralement associées à l'adaptation à la répartition des fruits. Souvent, les dents du calice ressemblent à des épines courbées sur le côté. Parfois, le calice entier ou ses dents grandissent considérablement, augmentant la dérive du calice à mesure que les graines sont dispersées par le vent, ou le calice devient de couleur vive, jouant un rôle pour attirer les insectes ou les oiseaux pollinisateurs. Ici, il a deux lèvres avec des lèvres entières et une fois le fruit mûr, il se brise en 2 parties qui ressemblent à des valves : celle du bas restant et celle du haut qui tombe. La partie supérieure du calice de nombreuses espèces de ce genre porte également un pli transversal en forme d'écaille - le scutellum.
Comme mentionné ci-dessus, la corolle des Lamiacées est généralement divisée en deux lèvres, dont la supérieure est formée de 2 pétales et la inférieure de 3 pétales. La lèvre supérieure peut être plate ou convexe, parfois elle est entière, de sorte qu'aucune trace de la présence de 2 pétales n'est retrouvée. La lèvre inférieure est presque toujours plus grande (un site d'atterrissage pour les pollinisateurs), trilobée avec un lobe moyen plus grand et souvent à son tour bilobé. Parfois ses lobes latéraux présentent des appendices filiformes, comme ceux du lamium (Lamium). La lèvre supérieure tenace est très courte par rapport à la longue lèvre inférieure, et la corolle semble également être à une seule lèvre. Il y a généralement 4 étamines dans les fleurs des Lamiacées, attachées au tube de la corolle. Il existe parfois un rudiment d'une cinquième étamine, qui a probablement disparu suite à la transformation de la corolle actinomorphe en corolle zygomorphe au cours de l'évolution des Lamiacées. La menthe (Mentha), avec son périanthe presque actinomorphe, possède les 4 étamines presque de la même longueur. La réduction des étamines au sein de la famille va encore plus loin - jusqu'à 2 étamines, et 2 étamines postérieures sont réduites, restant parfois sous forme de staminodes.
Les anthères des Lamiacées ont des formes différentes. Leurs nids sont généralement également développés, moins souvent l'un d'eux (généralement le devant) est moins développé que l'autre ou réduit. Chacune des anthères des deux étamines présentes ici s'est transformée en une sorte de dispositif à levier, à une extrémité duquel se trouve un nid d'anthères supérieur entièrement développé, et à l'autre, un rudiment généralement en forme de cuillère du second (inférieur). nid d'anthère. Le filament, qui s'est développé en un long filament (une partie de l'étamine située entre les nids d'anthères), est attaché de manière mobile à un filament très court.
Les nectaires des Lamiacées proviennent de la base des carpelles. Le type de nectaire le plus courant est un disque à 4 lobes ou dents. Chaque lobe peut sécréter du nectar, mais cette capacité dépend du degré de développement des lobes eux-mêmes et de leur système conducteur. Les insectes trouvent du nectar sous l'ovaire dans la partie inférieure de la corolle, mais lorsque le nectar est libéré en abondance, il remplit uniformément toute la partie inférieure du tube de la corolle et l'insecte n'a qu'à abaisser sa trompe dans le tube pour récolter beaucoup de nectar. .
La structure du gynécée de toutes les Lamiacées a beaucoup en commun. Il est toujours formé de deux carpelles avec un nombre de nids correspondant au nombre de carpelles. Cependant, chacun des nids est divisé en deux par une fausse cloison, ce qui fait que l'ovaire devient quadrilobé, avec un ovule dans chaque lobe. Le style de la plupart des Lamiacées s'étend de la base des lobes de l'ovaire (gynobasique). Bien que les fleurs des Lamiacées soient généralement bisexuées, dans de nombreux genres, il existe également des fleurs femelles avec des étamines rudimentaires, ayant généralement une corolle plus petite et de couleur pâle. Les fleurs mâles avec un gynécée rudimentaire sont beaucoup moins courantes.
Les relations des Lamiacées avec leurs insectes pollinisateurs sont très complexes et sont le résultat d'une longue évolution conjuguée : des espèces de genres aux fleurs les plus simplement disposées, possédant une corolle presque régulière avec un tube court et 4 étamines de longueur presque égale, sont généralement pollinisé par de petits hyménoptères et des mouches, car leur nectar est facilement disponible. Chez la plupart des autres Lamiacées à corolle à double lèvre bien définie, les étamines et le style sont adjacents à la lèvre supérieure, et le nectar est placé dans la partie inférieure d'un tube assez long. Les pollinisateurs de ces fleurs sont principalement des hyménoptères et des papillons, moins souvent de grosses mouches de la famille des syrphes. Les visiteurs d'une fleur touchent d'abord le stigmate, puis les anthères, et emportent une partie du pollen qui s'y trouve. Dans le fermoir et dans certains autres genres, la libération de pollen sur le dos de l'insecte est facilitée par la présence de poils orientés vers le bas sur les anthères, que l'insecte touche. Des dispositifs remarquables, comme un levier ou une barrière, qui permettent l'accès au nectar seulement après que le pollen a frappé le dos de l'insecte, se trouvent chez les espèces de sauge et de point noir (Prunella), mais ils atteignent la plus grande perfection chez les espèces de sauge, dans lesquelles les anthères des deux étamines existantes se transforment en une sorte de dispositifs à levier mobiles. L'insecte pollinisateur, afin d'obtenir du nectar, enfonce sa tête dans le tube de la corolle, pousse le rudiment expansé en forme de cuillère du nid d'anthère inférieur vers l'intérieur et vers le haut, et le nid d'anthère fertile, situé à l'autre extrémité du conjonctif allongé, frappe le dos de l'insecte et y déverse du pollen.
Chez certaines Lamiacées, les étamines et le style sont placés sur la lèvre inférieure, de sorte que l'insecte visitant la fleur (généralement des papillons) emporte le pollen sur la face inférieure de l'abdomen. Chez d'autres genres de Lamiacées, le même effet (position inférieure des étamines et du style) est obtenu en tordant le tube de la corolle (la lèvre supérieure devient comme une lèvre inférieure), en tordant le pédoncule et en inflorescence fortement tombante. La possibilité d'autopollinisation des fleurs de Lamiacées est souvent éliminée en raison de la maturation plus précoce des étamines par rapport au stigmate (protandrie), mais dans de nombreux autres cas, l'autopollinisation est tout à fait possible. Il convient de noter que chez de nombreuses Lamiacées, non seulement la corolle, mais aussi d'autres parties de la fleur et de l'inflorescence participent à l'attraction des insectes et des oiseaux.
Non moins unique est le fruit des Lamiaceae, constitué de 4 lobes à une seule graine en forme de noix ou rarement en forme de drupe, tandis que chez les Norichineaceae, dont la structure de la corolle est similaire, le fruit est généralement une capsule à plusieurs graines. Lors de la fructification, la corolle tombe généralement, mais le calice reste toujours et grandit souvent. L'endosperme est généralement absent des graines matures et est rarement conservé, ce qui constitue une caractéristique primitive. La membrane externe des lobes fœtaux porte souvent des tubercules, des papilles ou des poils, associés à leur mode de distribution.
De nombreuses Lamiacées se propagent par le vent (anémochorie). Les unités de distribution - les diaspores - dans ce cas sont généralement des parties à graine unique d'un fruit fractionné, dont la dérive peut augmenter en raison de leur pilosité ou de la formation d'excroissances en forme d'aile ou de touffe. Chez les Lamiacées anémochores, les tiges restent souvent sèches longtemps, dispersant progressivement les fruits (même en hiver). Dans d'autres cas, au contraire, les tiges ramifiées évasées aux inflorescences fruitières se cassent facilement à leur base et roulent sur la steppe avec le vent, dispersant progressivement les fruits. Plus les fruits ne tombent pas longtemps des gobelets, plus la distance à parcourir est grande. Ainsi, de nombreuses Lamiacées possèdent des dispositifs permettant de maintenir les fruits dans le calice : un anneau de poils dans son pharynx ou des dents recourbées vers l'intérieur.
Chez de nombreuses Lamiacées anémochores, les lobes du fruit tombent avec le calice. Dans ces cas, le vent est obtenu soit en raison des dents relativement longues et souvent ciliées du calice, soit en raison de la forte croissance du tube du calice et de ses dents.
Parmi les Lamiacées, il existe de nombreuses espèces qui se propagent grâce à l'aide des animaux. De plus, les adaptations à la zoochorie ne sont pas moins diverses. De nombreuses Lamiacées ont des membranes mucilagineuses des lobes des fruits lorsqu'elles sont mouillées et peuvent se propager à la fois par endozoochore (avec l'aide d'animaux frugivores, principalement des oiseaux) et par épizoochore (sur la laine et les plumes, ainsi que sur les pattes des animaux et des humains). Une plus grande efficacité de l'endozoochorie est obtenue grâce à la formation de lobes du fœtus en forme de drupe avec une coquille charnue juteuse. Les espèces à lobes de fruits adhésifs ou poilus se propagent de manière épizoochore. Dans de nombreux cas, la propagation épizoochorique est également facilitée par la chute des calices avec les fruits, les poils durs et les dents dures dépassant sur les côtés, qui constituent un excellent dispositif d'ancrage dans la fourrure animale.
Les fruits de certaines Lamiacées (en particulier les espèces de poissons tenaces et de demoiselles) ont des appendices disposés de diverses manières qui servent de nourriture aux fourmis. Ils se caractérisent par le mode de distribution dit myrmécochore.
Les espèces de Lamiacées qui vivent près des rives des plans d'eau et dans les marécages (par exemple, les espèces de menthe et de sauterelle) ont des lobes de fruits flottants, adaptés à la dispersion par les courants d'eau, mais en partie aussi par les animaux aquatiques.
Le système des Lamiacées est encore loin d’être parfait et est en cours de développement. Selon l'un des derniers systèmes de la famille des Lamiacées, développé par le botaniste allemand H. Melchior (1964), elle est divisée en 9 sous-familles.
L'odeur aromatique caractéristique de la plupart des espèces de Lamiaceae est très importante, qui est déterminée par la présence sur tout ou partie de la plante de glandes qui sécrètent des huiles essentielles de composition complexe (elles comprennent des alcools aromatiques, des phénols, des terpènes, des aldéhydes et d'autres substances organiques). composés). C'est la présence de ces huiles qui détermine en grande partie l'utilisation pratique des Lamiacées comme plantes techniques, médicinales et aromatiques.

 Entrée
Entrée